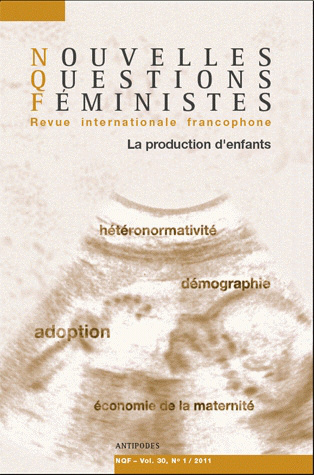
Nouvelles Questions Féministes, vol. 30-n°1/2011
Françoise MESSANT,Marianne MODAK,Anne-Françoise PRAZRésumé
Il y a une certaine ambivalence, voire de la méfiance, chez les féministes radicales face à la question des enfants, et ceci pour de bonnes raisons : d'une part, la production d'enfants est l'obstacle principal à l'égalité entre les sexes ; d'autre part, la maternité a été historiquement construite comme étant incompatible avec la participation à la sphère publique, renvoyant ainsi les femmes au privé. Par ailleurs, tant les positions essentialiste que celles du sens commun, font de la maternité leur argument massue, à la fois preuve de l'existence d'une différence biologique entre les femmes et les hommes à l'avantage des premières, et justification du maintien de leur situation spécifique complémentaire dans l'ordre hétérosexuel existant. Cette méfiance légitime des f ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
21.00 €
Ajout au panier /
