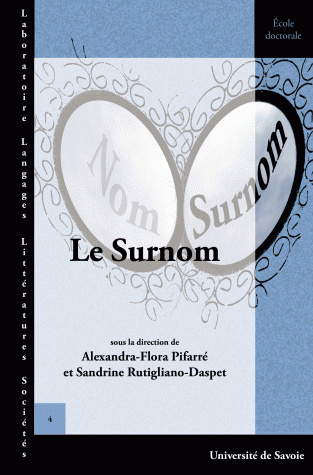
Le Surnom
Alexandra-Flora PIFARRÉ,Sandrine RUTIGLIANO-DASPETCollection
École doctoraleDate de publication
3 novembre 2008Résumé
Le surnom est un attribut que l'on donne mais aussi que l'on reçoit. Il y a la loi et la juridiction liées à l'acte de nommer, mais aussi un usage, une pratique. C'est le cas du pseudonyme et du surnom. Dès l'époque romaine, l'identité du citoyen comprenait, en plus du nom et du prénom, un surnom : le cognomen. Plus tard, les Gaulois, qui prirent des noms romains, gardèrent leur nom gaulois comme surnom. La christianisation et les invasions germaniques bouleversèrent les modes de désignation. En effet, ne gardant plus que les noms de baptême, une trop grande fréquence d'homonymes contraint les autorités à adopter des surnoms, d'abord germaniques, puis français dès le 11e siècle. Au 13e siècle, ces surnoms, qu'ils aient été choisis en fonction d'un caractère moral, physi ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
15.00 €
Ajout au panier /
