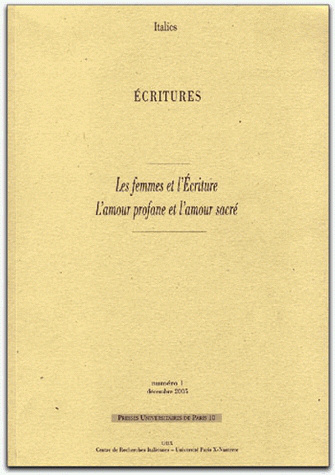En deçà et au-delà de l'écriture, Claude Cazalé Bérard
Quête de Dieu et recherche de modèles. Naissance d'une tradition féminine dans la mystique allemande (XIIe-XIVe siècles), Laurence Moulinier-Brogi
La poésie du " pianger roco ". Vittoria Colonna entre amour profane et amour sacré, Chiara Pisacane
" Amo ergo sum ", Frédérique Verrier-Dubard
Saintes et guerrières. L'héroïsme au féminin dans l'œuvre de Lucrezia Marinella, Laura Benedetti
Le Manifeste sur l'immortalité de l'âme de Sarra Copia Sulam Hebrea (Venise, 1621), Michèle Bitton
Madame Guyon et les figures bibliques. Application mystique et expérience de la maternité spirituelle, Sophie Houdard
L'amour divin comme instrument de l'amour profane chez les femmes selon Mary Astell (1666-1731), Guyonne Leduc
Cet ouvrage propose de rechercher, dans la longue durée, les traces d'une généalogie féminine à laquelle rattacher les auteures, dont les parcours avaient été retracés pour le XXe siècle, et aussi d'identifier les circonstances, les conditions, les modalités dans lesquelles avait pu se construire, dans l'histoire européenne, jusqu'à la fin de l'Ancien régime, un espace féminin de l'écriture. C'est à ces figures, souvent des pionnières, que l'on doit la première contestation d'un ordre donné comme immuable et universel – celui de la domination masculine dans les domaines du profane et du sacré : d'où, le choix périlleux, au risque de leur vie (et peut-être de leur salut) pour certaines, comme Hadewijch d'Anvers ou Marguerite Porete, de se soustraire au carcan de l'écriture canonisée et institutionnalisée – à commencer par le modèle inégalable du Livre – pour pouvoir fonder leur propre écriture visionnaire ou prophétique, savante ou populaire, jusqu'à atteindre, à travers l'épreuve de l'anéantissement de soi, le dépassement même des Saintes Écritures. Par delà les distances historiques et culturelles, c'est leur prise de conscience de soi, sous l'aspect de la différence, de l'inadéquation, de l'insuffisance, mais aussi, paradoxalement, leur capacité à s'affirmer (" évangéliquement ", pour les chrétiennes) comme signe de contradiction et instrument de renouveau, qui constituent un lien et une solidarité entre ces femmes habitées par le désir de Dieu.