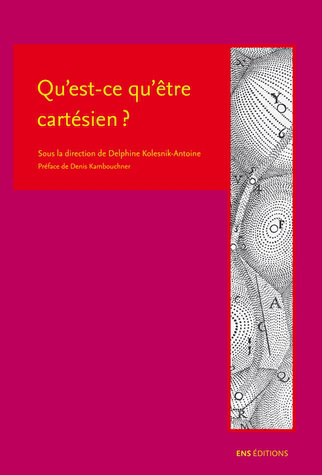
Qu'est-ce qu'être cartésien ?
Delphine KOLESNIK,Delphine KOLESNIK-ANTOINERésumé
Qu'est-ce qui fait la spécificité du cartésianisme dans l'histoire des idées ? Ce volume propose une réponse à cette question : le cartésianisme peut tout aussi bien se penser à l'aide des outils d'une histoire de la philosophie classique recourant à la philologie, aux " sources " et à l'intertextualité, y compris en des termes critiques ; que dans les lexiques de la réfraction, de la transformation voire de la construction, rationnelle ou imaginaire. Dans ce dernier cas, on peut parfaitement revendiquer la neutralisation des exigences de continuité attestables entre l'invention et la source originelle et tenter de penser des Descartes ad hoc, étant entendu qu'une telle entreprise aura toujours, en retour, quelque chose à nous apprendre sur le corpus d'origine. De Desca ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
38.00 €
Ajout au panier /
