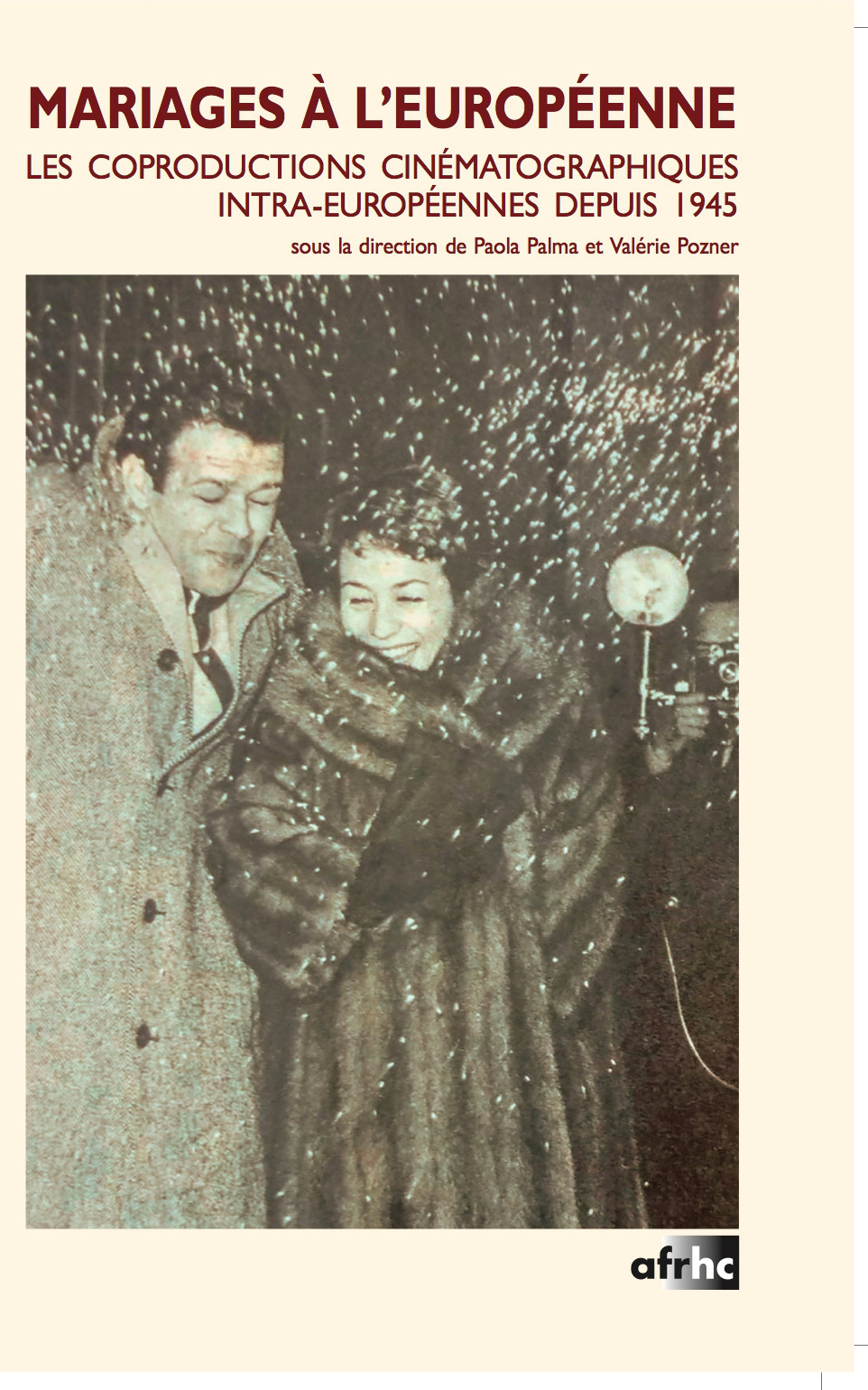Palma, Paola et Pozner, Valérie – Introduction
I. Enjeux économiques et politiques
Mituyrova, Ekaterina – Les coproductions franco-soviétiques des années 1950-1970: entre enjeux économiques et politiques ;
Pisu, Stefano – Les coproductions italo-soviéiques (1950-1970) : coopération réelle entre Est et Ouest ou occasion manquée ?
Leventopoulos, Mélisande – Du homard par temps de crise ? Les coproductions gréco-européennes contemporaines.
II. Coproductions, circulations, transferts culturels
Palma, Paola – Exporter une actrice et une carrière : Eleonora Rossi Drago et la coproduction franco-italienne ;
Fournier, Caroline – Coproductions et versions multiples dans l'Espagne franquiste de 1955 à 1967 ;
Valkauskas, Elodie – Les coproductions ouest-allemandes sur le marché cinématographique français entre 1962 et 1969 ;
Skopal, Pavel – Des histoires tchèques pour les enfants allemands. Les coproductions germano- tchécoslovaques pour la jeunesse dans les années 1970 et 1980.
III. Géopolitique des coproductions
Vasile, Aurelia – Les coproductions cine ´matographiques franco-roumaines comme stratégie d'affirmation internationale de la Roumanie (1956-1963) ;
Ragaru, Nadège – " Si tous les Allemands étaient nazis, comment serions-nous là ? " Quand cinéastes bulgares et est-allemands négociaient une vision " est-européenne " ; de la Seconde Guerre mondiale ;
Cenek, David – Les coproductions cinématographiques franco-tchécoslovaques entre 1958 et 1970 comme moyen de relance des relations bilatérales ;
Gallinari, Pauline – Le Conseil de l'Europe: histoire et devenir d'un acteur au service de la coproduction européenne.
Mariages durables ou éphémères, mariages harmonieux ou contrastés, mariages féconds, mariages inattendus, mariages d'amour, mariages forcés ou arrangés... Ce livre veut raconter un aspect important de l'histoire du cinéma européen : la coproduction cinématographique constitue un champ de recherche vaste et encore largement inexploré.Dans un contexte politique, diplomatique et économique nouveau, qui est celui de l'après-guerre, l'Europe et son industrie cinématographique doivent faire face tout à la fois à l'arrivée massive de la concurrence hollywoodienne, aux tensions entre l'Est et l'Ouest, à la nécessité d'intégrer les nouveautés techniques (la couleur, les grands formats), ainsi qu'à une nouvelle mais nécessaire internationalisation de la production, de la distribution, et de l'exploitation cinématographiques. L'une des réponses apportées à ces questions est la mise en place, pour la première fois, d'accords officiels – c'est à dire intergouvernementaux – de coproduction. Après l'initiative pionnière de 1946 entre la France et l'Italie, ce modèle se répand graduellement dans toute l'Europe, et, sous des formes qui ont évolué dans le temps, il est encore en vigueur aujourd'hui.Des chercheurs européens, spécialistes de terrains variés – Allemagne(s), Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Italie, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS – apportent leur contribution approfondie et documentée à cette exploration, ample à plus d'un titre. La période couverte va de la sortie de guerre à aujourd'hui. Réalisateurs, scénaristes, acteurs... célèbres et moins célèbres sont impliqués, comme les catégories d'œuvres les plus variées : du film musical au drame d'auteur, de la science-fiction au film historique consacré à un passé récent et douloureux, du dessin animé à la série télévisée, du mélodrame au film pour enfants. Ces collaborations ont impliqué des pays appartenant aux mêmes blocs idéologiques – l'Est et l'Ouest – mais elles ont aussi traversé le rideau de fer, faisant fi des glaciations géopolitiques, et constitué un élément de continuité de l'histoire culturelle globale de l'Europe.Qu'elle ait été vécue comme une contrainte ou comme une occasion rêvée d'échapper aux carcans nationaux, la coproduction cinématographique a toujours revêtu la forme d'un drôle de mariage, dont les multiples variations ont donc contribué– et contribuent encore – à façonner l'identité culturelle européenne.