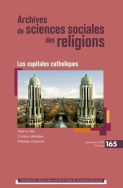
Archives de sciences sociales des religions, n° 165/2014
Les capitales catholiques
CollectifDate de publication
25 avril 2014Résumé
Dans les pays les plus catholiques, les capitales comme Bruxelles, Paris, Port-au-Prince, Québec ou Rome ont cristallisé l'opposition traditionnelle entre les métropoles, lieux de perdition morale, et les villages, lieux de préservation de la foi ancestrale. Quelles stratégies de reconquête urbaine les catholiques ont-ils déployées depuis au moins deux siècles, conscients que l'avenir se joue aussi au centre? Quelles lectures du monde urbain et quels imaginaires des villes ont-ils proposés?Dans ce dossier thématique, des spécialistes de différentes disciplines montrent que les mouvements catholiques ont engendré des dynamiques propres où la capitale s'est imposée comme " terre de mission " et objet de " croisades " pastorales à travers la popularisation de lieux de cult ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
22.00 €
Ajout au panier /
