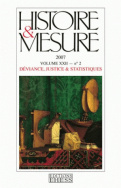
Histoire & Mesure, volume XXII, n° 2/2007
Déviance, justice et statistiques
Revue
Histoire & MesureDate de publication
17 décembre 2007Résumé
La médiatisation des chiffres de la police et de la justice, et les guerres de chiffres qu'elle entraîne, ne sont jamais univoques. Au carrefour de l'histoire du droit et de la justice, de l'histoire sociale et des statistiques, ce volume aide à comprendre les débats sur les chiffres du crime, de la police et de la justice.Cette sur-représentation des statistiques ne sont pas propres à la France du 21e siècle. Parmi les premières statistiques officielles publiées, dès le début du 19e siècle dans certains pays européens, on compte celles des crimes et des procès.Leur production est tributaire de l'activité des policiers, gendarmes, procureurs et juges et de ses supports matériels, des registres au casier judiciaire informatisé : tout cela impose des unités de compte parf ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
22.00 €
Ajout au panier /
