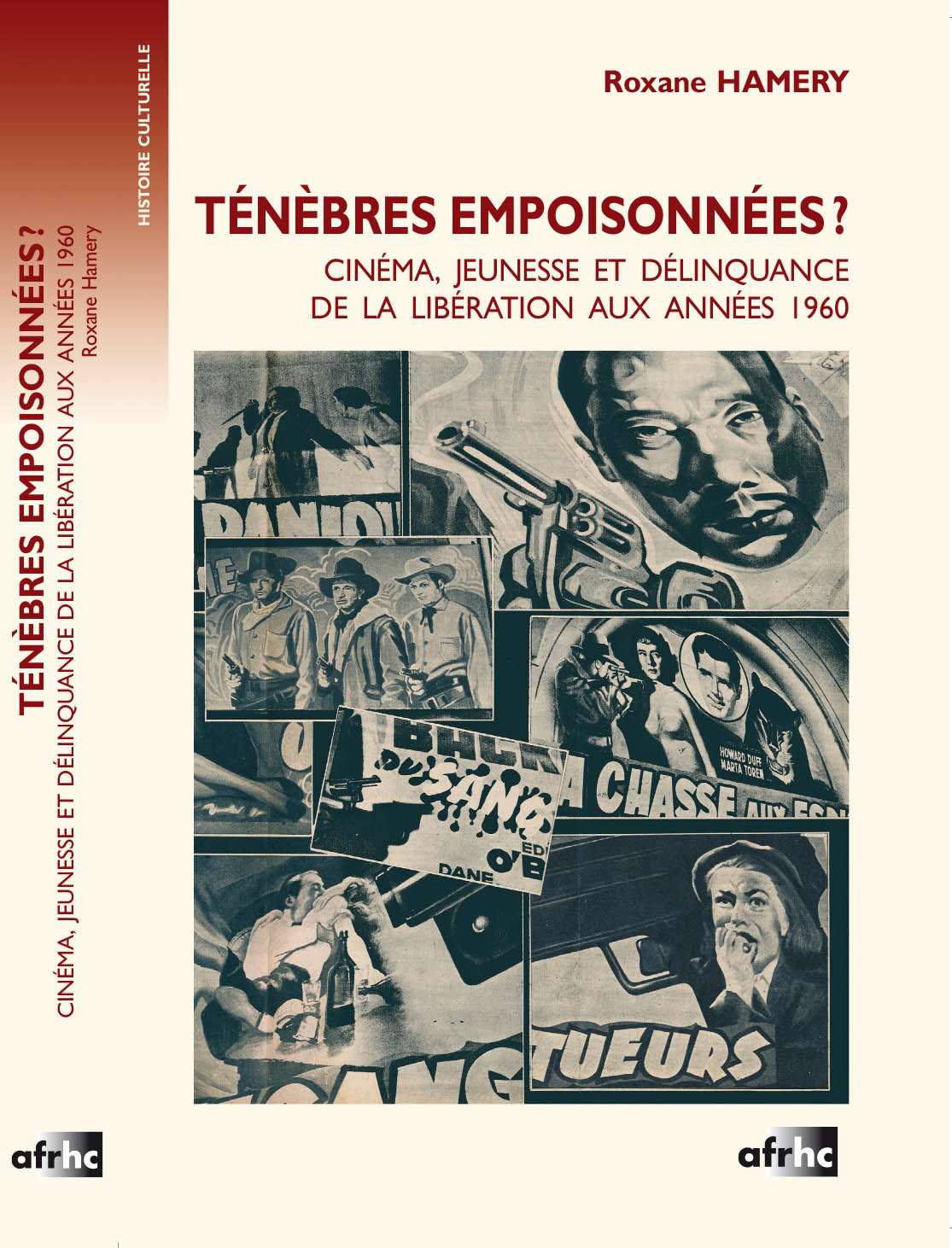Introduction
I/ Le cinéma, fait de civilisation ou fléau social ?
1/ Les dangers du cinéma : des fantasmes et hypothèses qui traversent le temps
L'héritage des recherches de Maurice Rouvroy
Les Payne Fund Studies : un modèle pour les recherches françaises ?
Les puissances du cinéma
L'amoralité des films
Prouver la menace
2/ Les jeunes, premiers spectateurs du cinéma : données quantitatives
Trois enquêtes sur le public juvénile
Le taux de fréquentation global
Le taux de fréquentation par âge et par sexe
Les autres critères influant sur le taux de fréquentation
Les différents modes de fréquentation
3/ Les goûts des jeunes spectateurs : données qualitatives
Les préférences des filles
Les préférences des garçons
La capacité critique du jeune public
II/ Les acteurs de la justice des mineurs face au cinéma
1/ Les magistrats confrontés à des délits liés au cinéma
La doctrine de la défense sociale : cadre des débats sur le cinéma
Les observations directes des juges : une approche pragmatique de la question du cinéma criminogène
L'enquête de 1948 menée auprès des juges des enfants : des résultats qui sont l'exception et non la règle
Qu'est-ce qu'un film dangereux ? la preuve par l'exemple
2/ Les difficultés de la grande enquête nationale de l'Éducation surveillée sur le cinéma et la délinquance
La lente élaboration de l'enquête nationale sur le cinéma : 1947-1948
Les évolutions des protocoles d'observation en 1948-1949
Les bilans de la partie sociologique de l'enquête en 1951-1952
Les bilans de la partie psychologique de l'enquête en 1952 et l'orientation vers le filmodrame
1959-1962 : vers une reprise des recherches ?
3/ De quelques enquêtes particulières sur le cinéma menées auprès des établissements d'Éducation surveillée
Enquêtes et militantisme : servir un discours propagandiste
Focus sur le public féminin (France/Belgique)
Une spécificité de goût française : étude du processus d'identification à Eddie Constantine
III/ L'essor des débats : les tentatives de coordination
1/ Une convergence de réflexions entre les professionnels de l'enfance et les recherches de la filmologie
La question centrale du jeune public : les enfants inadaptés, population représentative de la jeunesse ou cobayes d'exception ?
Les finalités ambiguës des recherches sur le public juvénile
Le champ des recherches filmologiques en Italie : une incursion du social et du politique plus assumée
2/ Parler d'une même voix : l'enjeu des congrès sur le cinéma et la jeunesse
Les cadres généraux des échanges et discussions : vers la constitution d'un réseau fédéré ?
Les orientations principales des congrès : de l'impossible délimitation d'un objet d'étude
Du congrès de Milan en 1952 à la fondation de l'Institut pour l'étude expérimentale des problèmes sociaux de l'information visuelle (ISPSIV) en 1960 : un renouveau des études sur la jeunesse et le cinéma est-il possible ?
3/ La rencontre du monde de la justice, de la filmologie et du cinéma
La part grandissante des recherches sur le cinéma dans les publications de criminologie
Des magistrats analysent la représentation du crime à l'écran et ses effets
Le positionnement complexe de la critique cinématographique
IV/ Dompter le vice, former les esprits
1/ Maxima debetur puero reverentia : la prévention légale et le cinéma
Renforcer l'encadrement légal du cinéma
Le durcissement de la censure et la réforme de 1961
Mais que pensent les détracteurs de la censure des nouvelles mesures de protection de la jeunesse ?
2/ " Le cinéma comme moyen de défense sociale dans l'éducation des jeunes "
Valeur prophylactique du ciné-club de jeunes et formation d'un goût légitime
Les visées du ciné-club en milieu fermé : vocation corrective et terrain d'observation privilégié pour l'enquête sur le cinéma et la délinquance
Les formules du ciné-club en milieu fermé
La formation cinématographique des éducateurs
3/ Le cinéma, reflet des maux de la jeunesse… de la justice et de l'éducation
Le Carrefour des enfants perdus : une représentation de la justice des mineurs et de la rééducation très critiquée
André Cayatte au banc des accusés
Demain il sera trop tard de Léonide Moguy, un modèle " contre les films déprimants "
Conclusion
Sources et bibliographie
Index des noms
Index des films