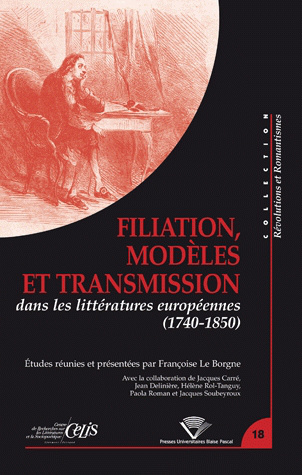
Filiation, modèles et transmission dans les littératures européennes (1740-1850)
Françoise LE BORGNECollection
Révolutions et romantismesDate de publication
27 février 2012Résumé
La tradition classique associe étroitement la question du genre – celle de la modélisation poétique – et celle des origines, les deux notions ayant en partage un étymon commun, le substantif latin genus, generis, qui désigne la naissance, la (bonne) race. Entre 1740 et 1850, cette autorité du modèle est remise en cause par de nouvelles voies de légitimation de l'œuvre littéraire fondées sur une revendication d'originalité et de contribution à l'élaboration des cultures nationales. Les modèles qui circulent alors à travers toute l'Europe – Shakespeare, Rousseau, Goethe, Victor Hugo... – invitent leurs émules à rejeter toute imitation servile pour créer des œuvres nouvelles, à l'image de sociétés en pleine mutation. Les contributions rassemblées dans ce volume analysent l ...
Lire la suite
FORMAT
Produit proposé à la vente en plusieurs composants
30.00 €
Livre broché
27.00 €
Ajout au panier /
