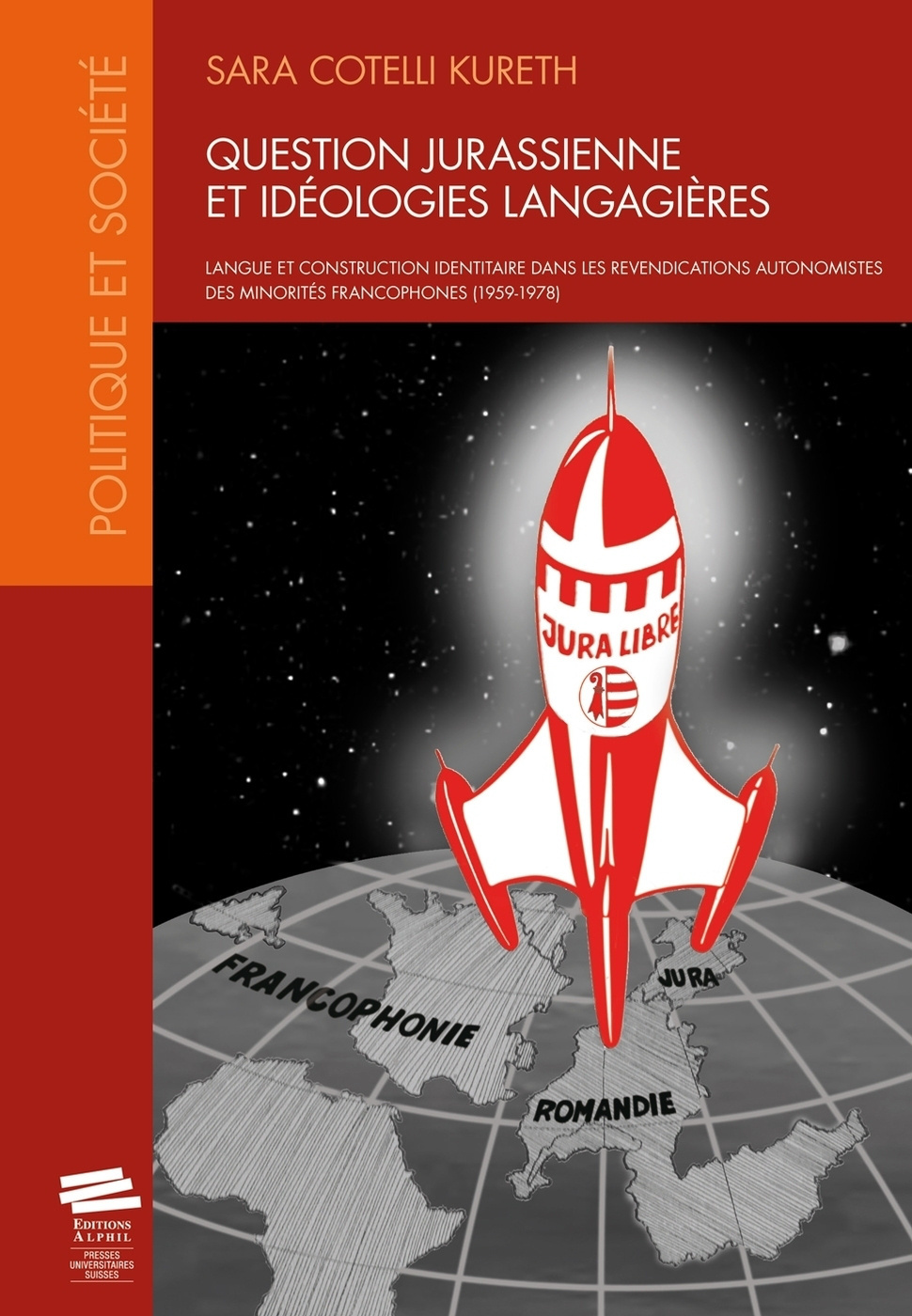Remerciements
Liste des abréviations
Introduction
Chapitre 1 – Jalons géographiques et historiques : le Jura romand et la Question jurassienne
1.1. Considérations géolinguistiques sur le Jura
1.1.1. La géographie du Jura en bref
1.1.2. La situation linguistique dans le Jura historique en 1960
1.2. Bref aperçu historique de la question jurassienne
1.2.1. Le Jura historique 1.2.2. Le " réveil du peuple jurassien "
1.2.3. Le premier plébiscite
1.2.4. Le RJ et l'Association européenne de l'ethnie française (AEEF)
1.2.5. Les " années de braise "
1.2.6. L'heure des peuples frères
1.2.7. Le second plébiscite
1.2.8. Jura-Nord et Jura-Sud
1.2.9. La construction du 23e canton
1.3. Quels acteurs ?
1.3.1. Les penseurs du RJ : Roger Schaffter et Roland Béguelin
1.3.2. Les autres plumes langagières du Jura Libre
Chapitre 2 – Théorie, méthodologie et corpus : une sociolinguistique historicisante
2.1. La recherche face à la question jurassienne
2.1.1. Mon Jura
2.1.2. Quels discours sur la Question jurassienne ?
2.1.2.1. Discours " laïques "
2.1.2.2. Discours universitaires
2.2. La recherche sociolinguistique sur les minorités
2.2.1. Minorités et nationalisme
2.2.2. Le discours des minorités linguistiques
2.3. Une étude de sociolinguistique historique
2.3.1. Pourquoi les idéologies langagières ?
2.3.2. Retour sur les concepts de base de la SH
2.3.2.1. Quelle conception de l'historique ?
2.3.2.2. Quelle conception du social ?
2.3.3. Le discours comme pratique sociale
2.3.3.1. L'héritage de Foucault
2.3.3.2. L'analyse du discours, l'anthropologie linguistique et la sociolinguistique critique
2.3.4. Sociolinguistique historique, sociolinguistique critique et analyse du discours
2.4. Le corpus
2.4.1. Les sources jurassiennes
2.4.1.1. Les sources médiatiques : le Jura Libre
2.4.1.2. Imprimés et brochures
2.4.1.3. Archives
2.4.1.4. Entretiens semi-dirigés
2.4.1.5. La représentativité du discours autonomiste
2.4.1.6. La voix des anti-séparatistes
2.4.2. Les sources romandes
2.4.3. Les sources étrangères
2.4.3.1. Les organisations internationales
2.4.3.2. Les peuples frères
Chapitre 3 – Le faisceau argumentatif du discours autonomiste jurassien
3.1. Les arguments historiques
3.1.1. L'histoire comme point de départ argumentatif
3.1.2. Quelle définition du Jura ?
3.2. Despotisme démocratique (arguments régionalistes)
3.2.1. Le Jura laissé pour compte
3.2.2. Majorisation et despotisme démocratique
3.2.3. Latins de Suisse : " Unissez-vous ! "
3.3. Arguments économiques et financiers
3.3.1. Un thème central
3.3.2. La question fiscale
3.3.3. Maitre chez soi
3.4. Arguments culturels, ethniques et linguistiques
3.4.1. Le génie jurassien : une prise de conscience et un réveil culturel ?
3.4.2. " Langagement " des poètes pour la liberté
3.4.3. Ethnie française et fédéralisme ethnique
3.4.4. Germanisation et territorialité des langues
3.5. Devenir jurassienne, devenir jurassien
Chapitre 4 – Les sources francophones et romandes des idéologies langagières du discours autonomiste
4.1. Petite histoire des idéologies langagières du français
4.1.1. L'obsession française de l'unité et de la pureté : une langue une
4.1.2. Le français langue de la République : équation entre langue et nation
4.1.3. Le génie de la langue : équation entre langue et culture
4.1.4. L'ordre naturel : équation entre langue et pensée
4.1.5. Sacralisation et perfection de la langue française : clarté et universalité
4.1.6. Destitution des patois et hiérarchisation des langues
4.1.7. Un des derniers avatars de l'essentialisme linguistique : la nocivité du bilinguisme
4.2. Aperçu du discours sur la langue en Suisse romande au XXe siècle
4.2.1. Le " romandisme " : une vision alarmiste de la Suisse française
4.2.2. La situation du français en Suisse romande dans le discours épilinguistique de 1900 à 1970
4.2.3. La bataille du gâteau au pruneau : soutien au français régional
Chapitre 5 – " Dialectes " et " langues de civilisation "
5.1. L'allemand et la " rugosité " du dialecte
5.1.1. Voltaire contre Goethe
5.1.2. Bärnerdütsch : un patois qui s'ignore
5.1.3. La décadence de la langue
5.1.4. Une autre perspective : la Suisse allemand aux deux langues littéraires
5.2. Le chant ancestral du patois
5.2.1. Les plus français des Suisses : le patois comme instrument identitaire
5.2.2. Une position médiane : la saveur campagnarde du patois
5.2.3. Patois et liberté
5.3. Les avatars de l'idéologie de l'unilinguisme
Chapitre 6 – La mythification de la langue française et ses conséquences
6.1. La place du français dans le discours autonomiste jurassien
6.2. Les mythes unifiants du français
6.2.1. La langue de Molière : une langue de grande culture et une " fenêtre ouverte sur le monde "
6.2.2. La langue de Rivarol : une langue véhiculaire mondiale
6.2.3. Précision, clarté et rationalité de la langue de Voltaire
6.2.4. Nationalimse linguistique : la langue, âme d'un peuple
6.3. Quand parler juste, c'est bien penser
6.3.1. Ce que l'on conçoit bien…
6.3.2. Notre langue construit notre mentalité
Chapitre 7 – La face sombre du français
7.1. Le français fédéral et le français " relâché "
7.1.1. Définition du français fédéral
7.1.2. Purisme linguistique : le relâchement du langage
7.1.3. Les causes de la misère du langage dans le Jura
7.2. Quelle norme ?
7.2.1. Le français régional : une thématique esquivée
7.2.2. Une norme traditionnelle et puriste
7.3. Le purisme comme stratégie politique
7.3.1. Les conséquences du français fédéral
7.3.2. " Soyons fiers de bien parler " : un combat permanent contre l'" arme secrète " des Bernois
Chapitre 8 – Le bilinguisme : " français d'abord " !
8.1. La confusion du bilinguisme
8.1.1. Combien de bilingues dans le Jura ?
8.1.2. Les dangers du bilinguisme précoce
8.1.3. Bilinguisme et pureté de la langue
8.2. Bilinguisme territorial
8.2.1. Le bilinguisme institutionnel, " antichambre de la germanisation "
8.2.2. Le plurilinguisme en question : la Charte des langues fribourgeoise
8.3. Français d'abord
Chapitre 9 – Le " temps des solidarités "
9.1. La francophonie
9.1.1. Frilosité helvétique
9.1.2. Francophonie et ouverture au monde
9.2. Jura et peuples frères : " même combat "
9.2.1. Delémont, " capitale de la francophonie "
9.2.2. Wallonie, Vallée d'Aoste et Québec : un miroir pour le RJ
9.2.3. Silences
9.3. Les implications idéologiques de l'internationalisation
Conclusion
Bibliographie