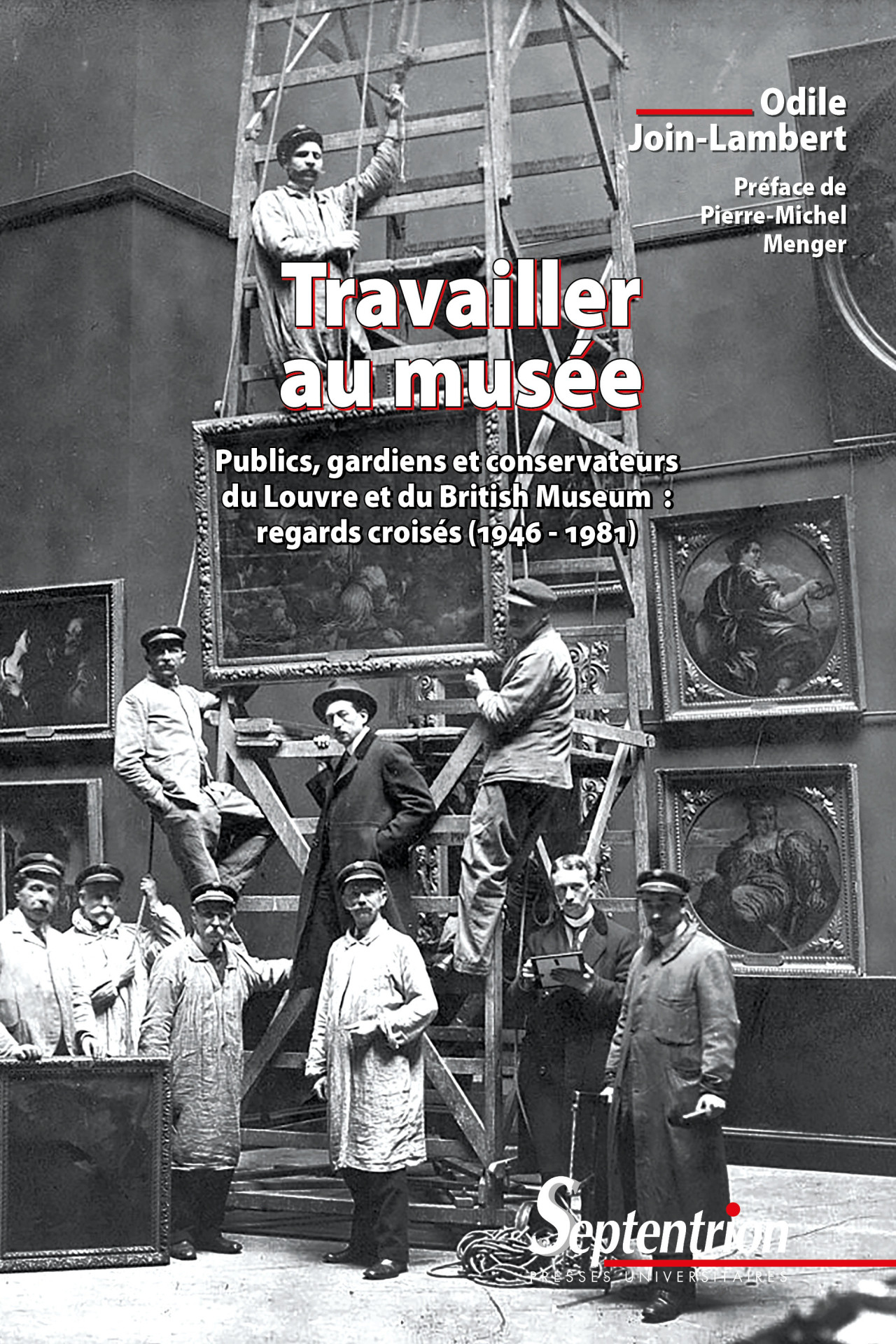Préface
Introduction
Une période d'extension des services culturels (1946-1981)
France-Grande-Bretagne : des comparaisons aux circulations
Travailler pour l'État : approches sociologiques et historiennes
Sources d'archives au Louvre et au Biritish Museum
Première partie.
Vers des circulations France – Grande-Bretagne (1920-1972)
Chapitre 1. Musées et publics dans l'entre-deux-guerres
I. État et associations professionnelles, une dynamique convergente
A. Le rôle de l'association professionnelle des conservateurs dans la modernisation des grands musées français
B. Une intervention progressive dans le laisser-faire britannique
II. Éduquer les masses, instruire la jeunesse
A. Une approche didactique du musée en Grande-Bretagne
B. L'impulsion de l'Office international des musées
C. Accompagner les visiteurs en France : une idée venue de Grande-Bretagne
Chapitre 2. Nouveaux échanges franco-britanniques après la Seconde Guerre mondiale
I. Le développement de liens bilatéraux
A. Des groupements anglophiles passeurs d'idées sur la Culture
B. L'ouverture d'espaces d'action sur l'emploi public
II. Circulations transnationales
A. Conserver ou éduquer
B. Une tentative de définition franco-britannique de la formation
Deuxième partie.
Hiérarchiser l'emploi dans les musées (1946-1981)
Chapitre 1. Gouvernement des musées et politique d'emploi
I. Une intervention croissante des autorités de tutelle
A. Le nouveau rôle du Parlement britannique sur la Culture
B. Musées nationaux, locaux et indépendants
C. Réaffirmation des collectivités locales en France
II. Classement des emplois et postes de travail
A. Compter la population administrative, une comparaison impossible
B. Une centralisation inachevée des emplois en France
C. Forte spécialisation et absence de mobilité en Grande-Bretagne
Chapitre 2. Des groupes professionnels en tension entre pôles scientifique et pédagogique
I. Conservateur n'est pas conservatrice en France
A. Catégoriser les destinataires
B. Accompagner les publics, un travail bénévole
II. La formation des personnels britanniques au regard de la France
Troisième partie.
Au nom du public. Le travail au Louvre et au British Museum (1946-1981)
Chapitre 1. Ce que les publics font au service public
I. Une éthique en pratique au British Museum
A. Servir le bien-vivre
B. Servants of the trustees ou servants of the Crown ?
C. Conseils whitley, service des publics et personnels
II. Commissions administratives paritaires et service public au Louvre
A. Le public, source d'indépendance des gardiens
B. Les conservateurs, entre le service de l'art et des publics
Chapitre 2. Les conservateurs : conserver ou transmettre
I. " Conserver " au Louvre
A. Le dévouement aux publics réservé aux conservatrices
B. La reconnaissance du mérite scientifique réservée aux conservateurs
II. Le public idéal des conservateurs
A. Des valeurs du passé
B. Un spécialiste non formé aux tâches de gestion et d'animation
III. " Diffuser " au British Museum
A. Gestionnaires, experts et chercheurs
B. Des origines hétérogènes
Chapitre 3. Les gardiens : surveiller ou guider
I. Reconversion des mérites militaires en mission de service public
A. Faire obéir les visiteurs en évitant d'être un guide
B. Sortir de la domesticité publique
C. L'occasion manquée d'une formation aux publics et aux œuvres
II. Une fonction divisée en deux au British Museum
A. Vers une fusion des attributions des chefs
B. Une formation réservée aux agents de sécurité
Conclusion
Le public, résultat d'une lutte entre groupes professionnels
Limites des circulations sur l'emploi public
Public et travail après 1981
Sources et bibliographie
Annexe. Fonctions et grades au British Museum en 1949, 1965 et 1975
Index
Remerciements