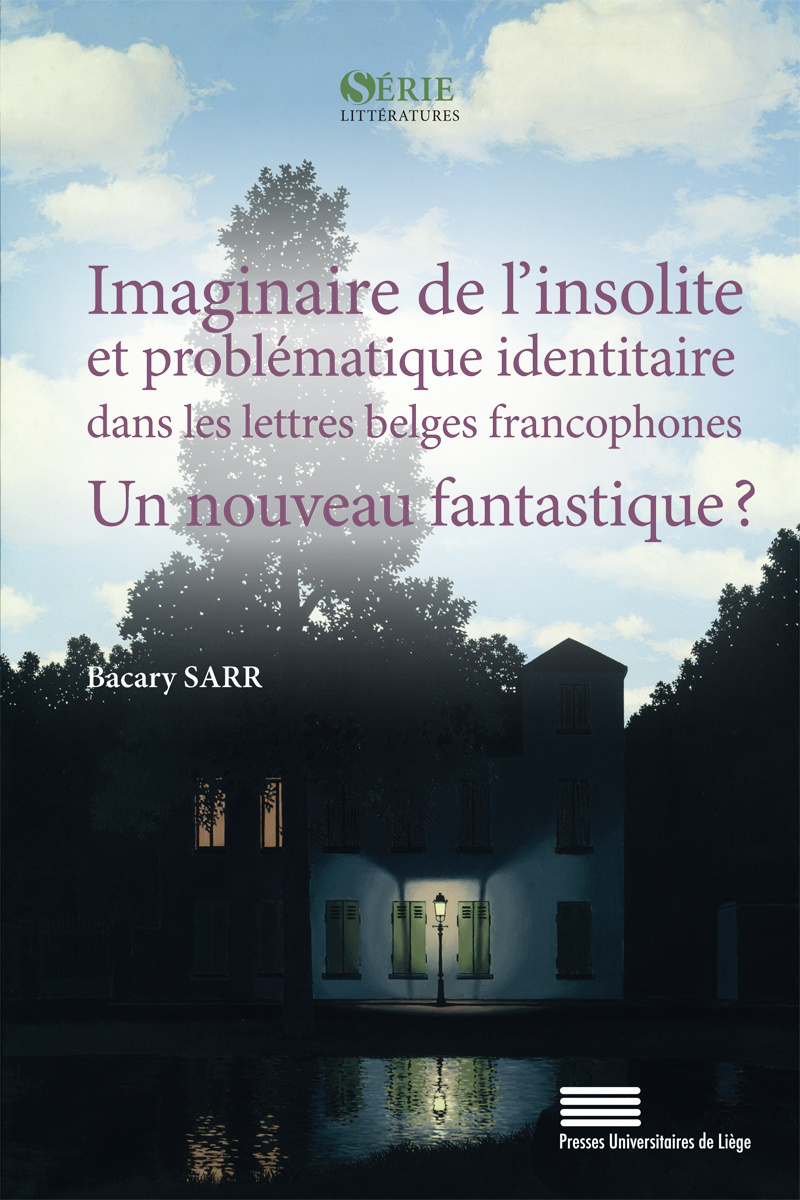
Imaginaire de l'insolite et problématique identitaire dans les lettres belges francophones : un nouveau fantastique ?
Baccary SARRCollection
Série LittératuresDate de publication
23 septembre 2021Résumé
On a coutume, lorsqu'il est question de littérature fantastique en Belgique francophone, d'avoir aussitôt à l'esprit les noms de Jean Ray, de Thomas Owen, de Franz Hellens, de Marcel Thiry, de Gaston Compère ou de Michel de Ghelderode. Tous ces écrivains ont, en effet, exploré le domaine, au point de faire considérer le fantastique comme un des traits spécifiques de la littérature belge. Des peintres comme Paul Delvaux et René Magritte, pour ne citer que les plus connus, ont, eux aussi, mais selon d'autres voies, donné à voir une forme de fantastique: leur "réalisme magique" éclaire ainsi le réel de façon éminemment poétique et transfigure le quotidien.Dans les années de crise d'identité des lettres belges d'après-guerre, un certain nombre de fictions romanesques semble ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
18.00 €
Ajout au panier /
