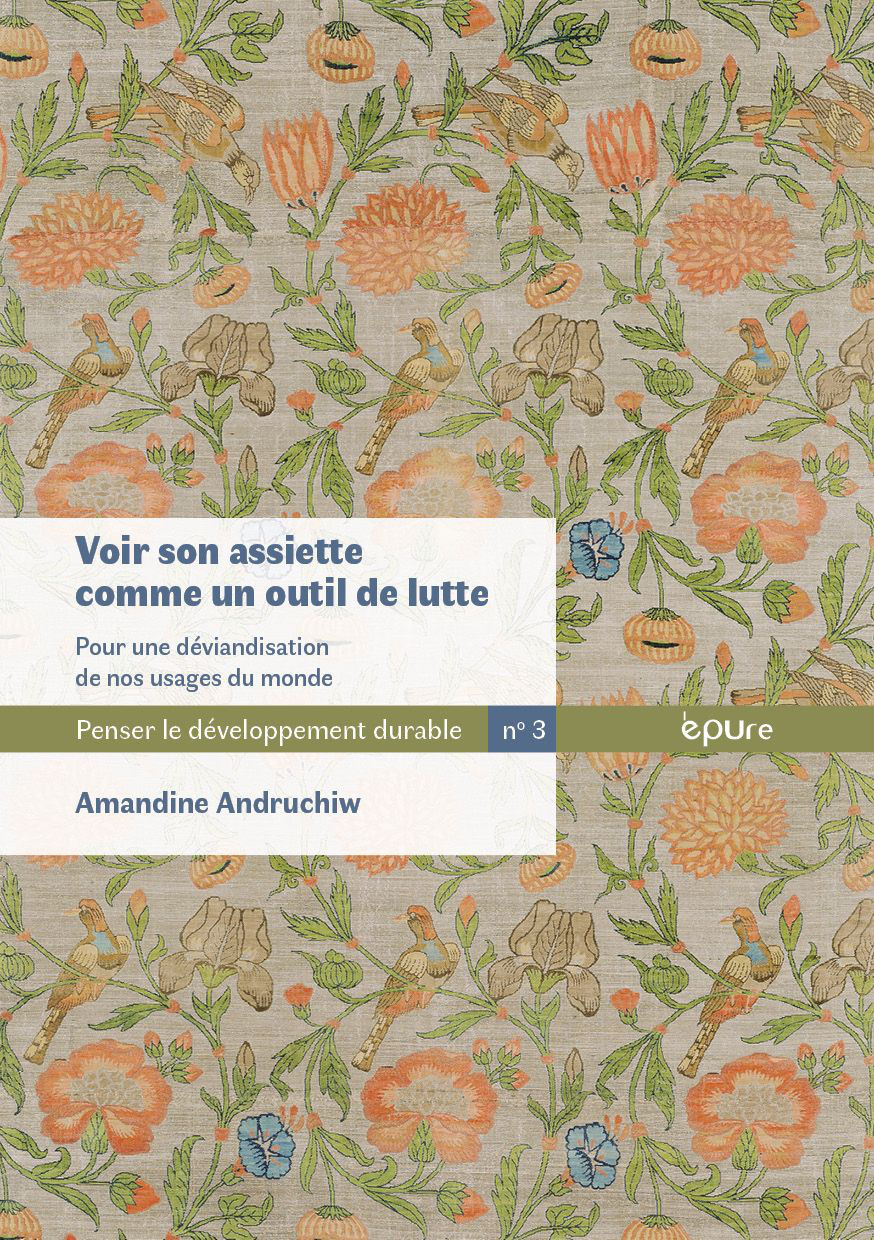
Végétarismes pluriels et déprise carniste
Amandine ANDRUCHIWCollection
Penser le développement durableDate de publication
19 juin 2025Résumé
La question du végétarisme est souvent marginalisée, raillée, voire invisibilisée dans les discussions autour des enjeux écologiques et politiques auxquels sont confrontées nos sociétés occidentales. Pourtant, des pratiques végétariennes éclairées et conviviales semblent proposer des avancées intéressantes vers davantage de justice sociale, une meilleure prise en compte du vivant dans son ensemble, et des individus humains et non-humains en particulier. Pourquoi alors tant de mépris ?Il est vrai qu'en révélant que la viande n'est pas l'alpha et l'oméga de nos assiettes, les pratiques végétariennes viennent heurter notre conception traditionnelle de la " bonne alimentation ", où la viande doit être au centre, à la fois sur le plan symbolique comme physique et physiologiq ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
14.22 €
Ajout au panier /
