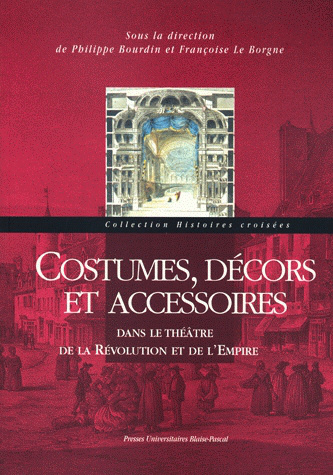
Costumes, décors et accessoires
dans le théâtre de la Révolution et de l'Empire
Philippe BOURDINCollection
Histoires croiséesDate de publication
20 septembre 2010Résumé
La concurrence entre les entrepreneurs de spectacles parisiens, les attentes du public, les possibilités techniques des salles les plus récentes favorisent une exigence de pittoresque dont le théâtre de la Révolution et de l'Empire fait son miel pour séduire l'imagination du spectateur. Celle-ci est également sollicitée par un usage nouveau des symboles et des emblèmes, empruntés aux grandes cérémonies républicaines à des fins d'édification morale ou de détournement parodique. Les critiques voient dans cette valorisation du spectaculaire le symptôme d'une dégénérescence du goût contemporain et d'une absence d'ambition intellectuelle du théâtre nouveau, mais la tragédie néo-classique leur oppose une exigence esthétique et morale réaffirmée, fondée sur la recherche de la ...
Lire la suite
FORMAT
Produit proposé à la vente en plusieurs composants
30.00 €
Ajout au panier /
