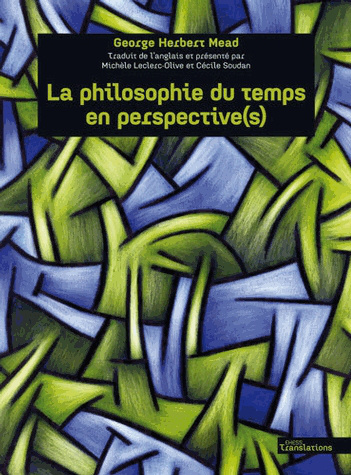
La philosophie du temps en perspective(s)
George Herber MEADCollection
EHESS-TranslationsDate de publication
2 novembre 2012Résumé
Dans la seconde phase de la pensée de G. H. Mead (1863-1931), le temps occupe une place fondamentale. G. H. Mead partage avec A. N. Whitehead le désir de relier la structure du monde physique, telle que les derniers développements de la science de ce début de XXe siècle la conçoivent, à l'expérience quotidienne. Cette préoccupation est partagée également par des auteurs comme B. Russell, G. E. Moore et même par des écrivains comme Virginia Woolf. La restitution de la philosophie anglo-saxonne dans le monde francophone accorde, depuis une dizaine d'années, un intérêt croissant à ces philosophies.La contribution originale de G. H. Mead à ces entreprises intellectuelles tient à ce qu'il est autant psycho-sociologue que philosophe. Il introduit dans ses dernière conférences ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
35.00 €
Ajout au panier /
