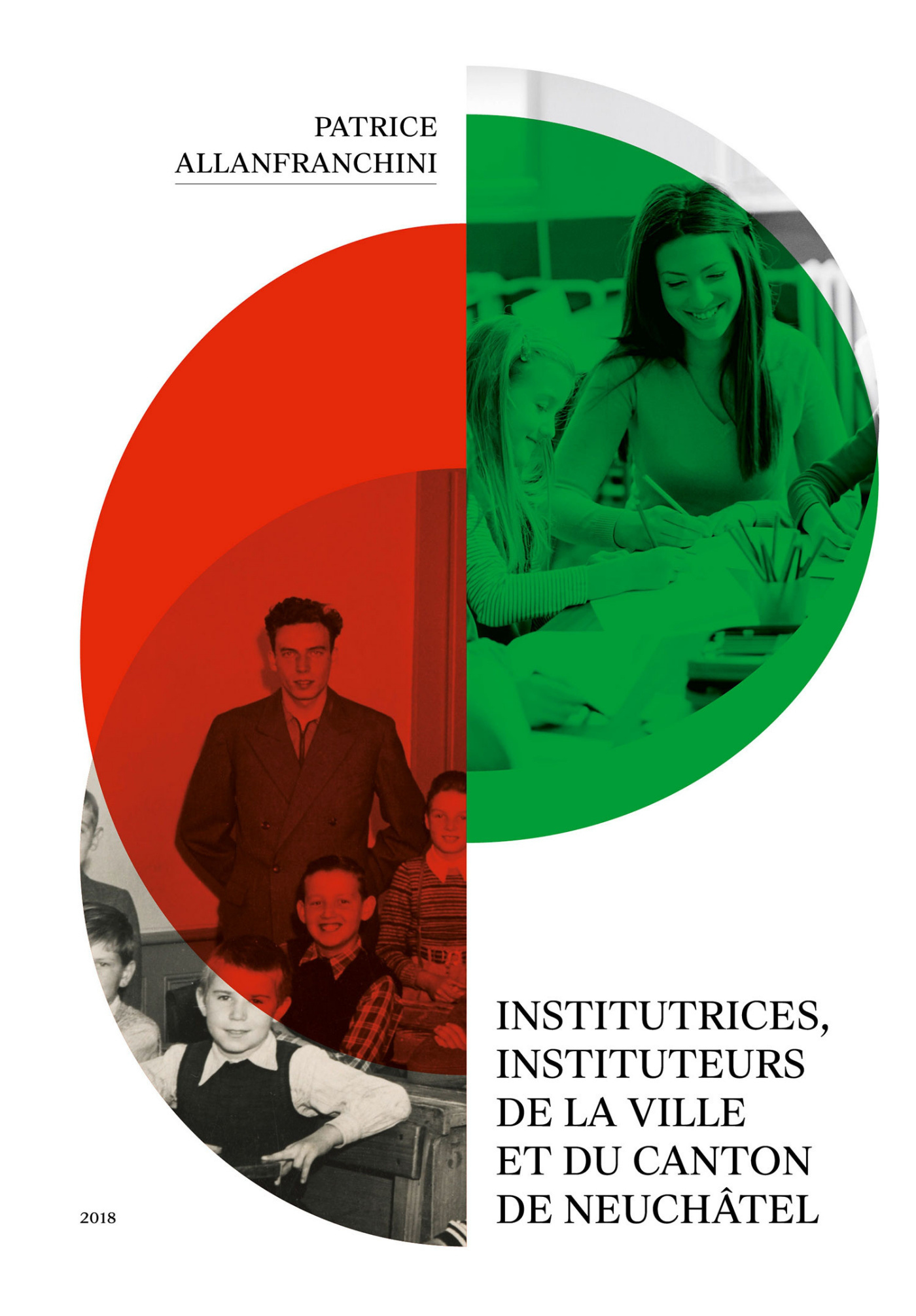Préface
Préambule
Chapitre 1 – Les prémices de l'école en terre neuchâteloise
1.1. Introduction
1.2. La première école
1.3. Un second régent
Chapitre 2 – Les améliorations des XVIIe et XVIIIe siècles
2.4. L'expansion
2.2. Les objectifs de l'école
2.3. 1701, le premier règlement scolaire
2.4. Un professeur de philosophie
2.5. Un règlement de 1787
2.6. Les basses écoles des garçons
2.7. Le collège
2.8. Les horaires dans les collèges
2.9. Les vacances
2.10. Les règles de promotions
2.11. Règlement particulier pour les régents
2.12. De l'inspection du collège et des écoles
Chapitre 3 – Régents, régentes, instituteurs, institutrices
3.1. Le terme d'instituteur
3.2. Un portrait d'instituteur en 1892
Chapitre 4 – Vers la mise en place d'un système scolaire moderne
4.1. Intervention de l'Etat dans le système éducatif
4.2. L'Etat des écoles
4.3. Les commissions communales d'éducation
Chapitre 5 – L'école primaire entre 1850 et 1920
5.1. L'enseignement froebelien
5.2. la durée de la scolarité
5.3. Vers une meilleure coordination scolaire
5.4. Un code scolaire
5.5. Vers une nouvelle loi, celle de 1908
5.6. Les suites de la loi
5.7. L'école enfantine
5.8. L'école primaire
5.9. L'école complémentaire
5.10. Les écoles spéciales
5.11. Le rôle de l'Etat
Chapitre 6 – L'évolution de l'école
6.1. Enseignement primaire
6.2. Enseignement pédagogique
6.3. Les révisions de 1932
6.4. En rappel
6.5. Avec les années quarante et cinquante
Chapitre 7 – Les conférences du corps enseignants
7.1. Quelques exemples
7.2. de la pédagogie expérimentale
7.3. La création libre des enfants
7.4. Des tests d'intelligence
7.5. Dès les années quarante
Chapitre 8 – L'instruction civique
Chapitre 9 – L'orientation professionnelle
Chapitre 10 – Des considérations pédagogiques
10.1. De nouveaux moyens
10.2. Vers des appréciations
Chapitre 11 – L'enseignement ménager
11.1. Les modifications législatives des années quarante
11.2. De l'école ménagère à l'économie familiale
Chapitre 12 – L'école primaire en ville de Neuchâtel de l'après-guerre aux années septante
12.1. Un essor démographique
12.2. De nouveaux bâtiments scolaires
12.3. Le collège du Crêt-du-Chêne
12.4. Les conséquences pour la ville de la refonte de l'enseignement secondaire : la construction du Mail
12.5. Les Acacias
12.6. Le problème des gauchers
12.7. Quelques décisions de la commission scolaire
12.8. La représentation du corps enseignant aux séances de la commission scolaire
12.9. Des visites de classe
12.10. La mauvaise littérature
12.11. Des cours de circulation routière
12.12. Le temps des enquêtes
12.13. Le problème des minorités religieuses
Chapitre 13 – Les services extrascolaires
13.1. Le service médico-pédagogique
13.2. L'office cantonal des mineurs
13.3. Une maison d'observation pour enfants difficiles
13.4. L'enseignement spécialisé
13.5. Le service dentaire
13.6. Le centre d'orthophonie
Chapitre 14 – Le cas des institutrices mariées
Chapitre 15 – Le domicile des enseignants
Chapitre 16 – La pénurie de personnel enseignant primaire
16.1. Les causes de la pénurie des années soixante
16.2. Prévision pour la période 1962-1971
16.3. L'organisation de cours spéciaux
16.4. Les dispositions du conseil d'Etat
16.5. Conditions de vie, rémunération et situation sociale
16.6. Un cercle vicieux
Chapitre 17 – Les duos
17.1. Arrêté du conseil d'Etat de 1976
17.2. Effets relatif à la première année d'expérience
Chapitre 18 – L'enseignement à temps partiel
Chapitre 19 – L'école normale
19.1. Les bâtiments de l'école normale
19.2. Une nouvelle vision de l'évaluation
19.3. Le deuxième bâtiment
19.4. La section école enfantine
19.5. Trois années d'études pour devenir instituteur
19.6. Le numerus clausus
19.7. Jean-Michel Zaugg
Chapitre 20 Des réformes scolaires
20.1. Classer les inovations
20.2. Pourquoi l'échec ?
20.3. Et la réussite ?
20.4. Appréciation du travail des élèves en 1ère année
Chapitre 21 – La prise d'importance de l'école secondaire au détriment de la formation primaire
21.1. La réforme scolaire neuchâteloise de 1961-1962
21.2. Le projet gouvernemental
21.3. L'intégration de la section P et de l'année d'orientation en 6e
Chapitre 22 – De CIRCE au PER
22.1. Une deuxième année pour l'école enfantine
22.2. Le PER
22.3. La réforme de l'école secondaire
Chapitre 23 – Conclusion
Bibliographie
Annexes
Publications