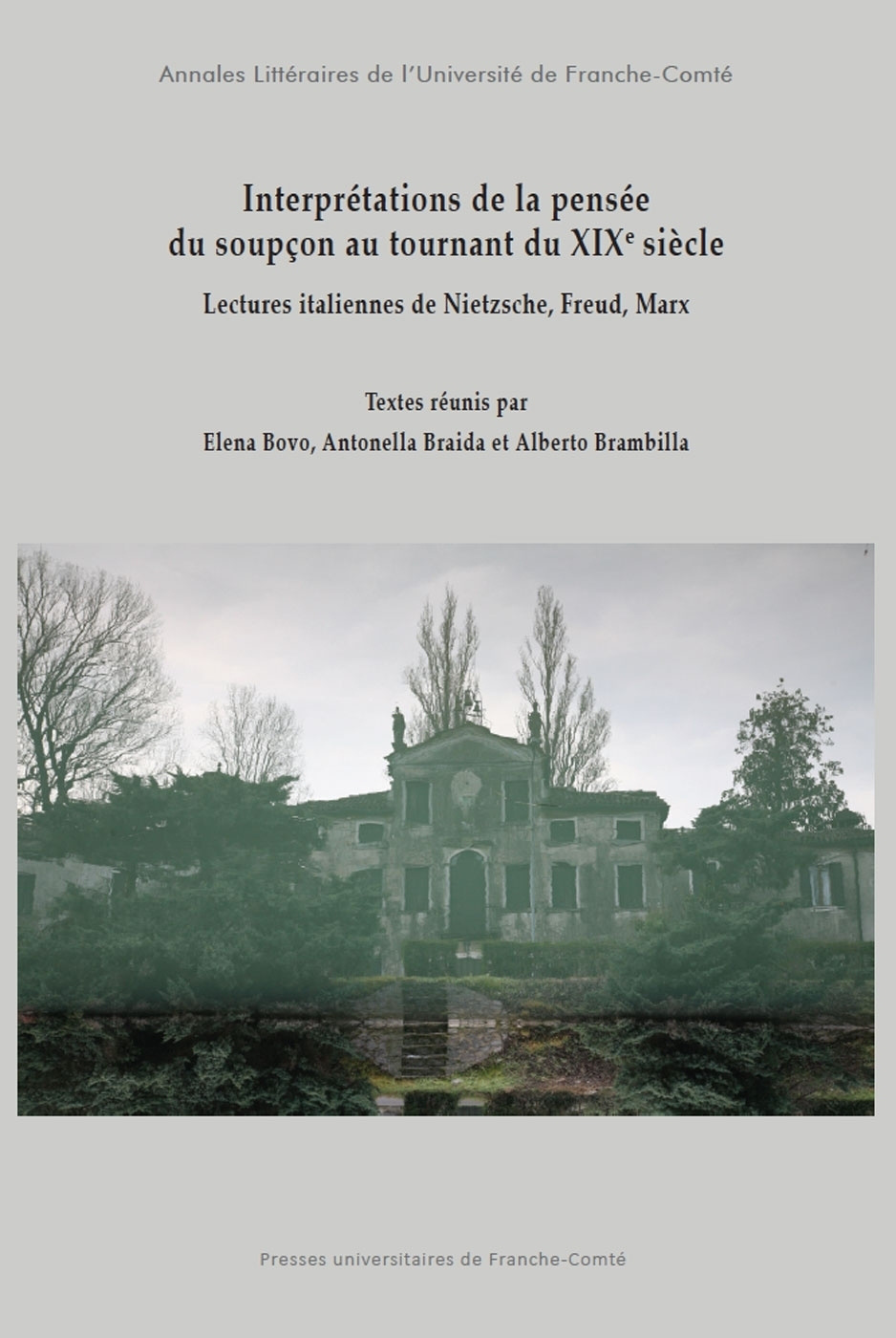
Interprétations de la pensée du soupçon au tournant du XIXe siècle
Elena BOVO,Antonella BRAIDA,Alberto BRAMBILLADate de publication
7 octobre 2013Résumé
" Le soupçon mitteleuropéen en Italie au tournant du XIX siècle ". Cet ouvrage rassemble les interventions de ce colloque tenu à Besançon en décembre 2009, qui a réuni historiens, historiens des idées et littéraires italiens et français. La question sous-jacente est de savoir à quel moment la pensée démystificatrice de Freud, Marx et Nietzsche est arrivée en Italie, selon quelles interprétations, et au prix de quelles trahisons conceptuelles. Pays catholique et profondément ancré dans ses traditions, instable, en quête d'une identité nationale, mais aussi critique envers l'Etat libéral et sa corruption, l'Italie voudra voir dans le conflit mondial une possible issue, puis dans le fascisme une révolution rédemptrice. Quelle fut, dans cette conjoncture, la place des " tro ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
13.00 €
Ajout au panier /
