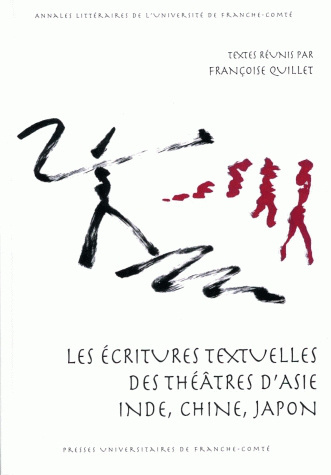
Écritures textuelles des théâtres d'Asie
Françoise QUILLETDate de publication
24 janvier 2011Résumé
On considère principalement les théâtres classiques d'Asie sous l'angle de la scène. Les formes mises en jeu répondent à des techniques, relativement codifiées, que l'on pourrait considérer comme des écritures, des " écritures scéniques ". Il ne faut pas omettre pour autant que ces théâtres sont sous-tendus par des textes, qui supportent l'entrelacement des expressions comme une trame soutient une broderie, des " écritures textuelles ".La richesse de leurs langages dramatiques apparaît dans les analyses des pièces indiennes, chinoises et japonaises présentées dans ce livre. Ce langage est différent de notre langage dramatique, n'étant pas passé par le pli aristotélicien. Sa spécificité nous invite à une réflexion sur l'écriture théâtrale et son fonctionnement dans des c ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
12.00 €
Ajout au panier /
