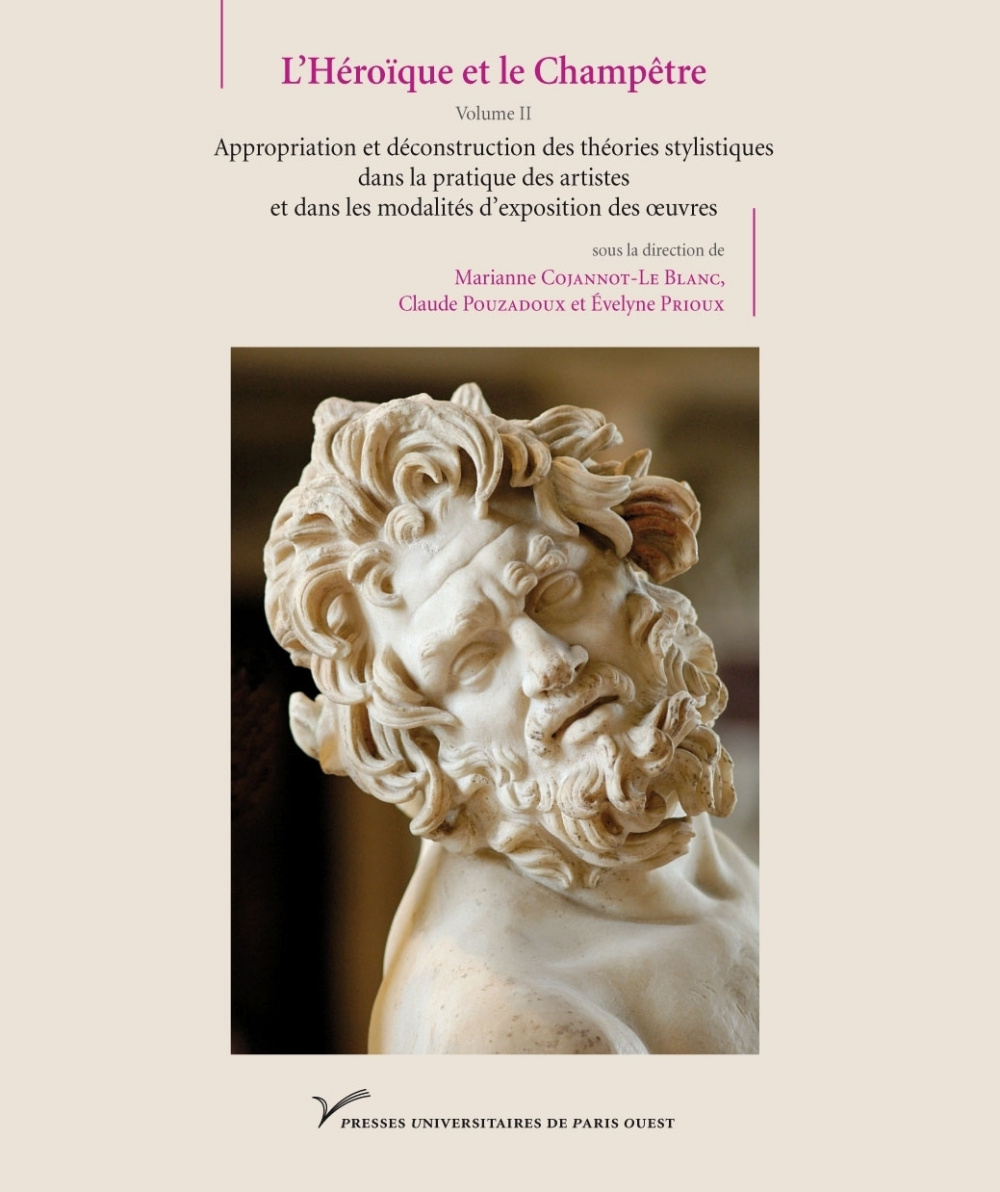
Héroïque et le Champêtre – Volume II
Marianne COJANNOT-LE BLANC,Claude POUZADOUX,Évelyne PRIOUXCollection
Modernité classiqueDate de publication
25 avril 2017Résumé
Le recours aux catégories rhétorico-poétiques est l'une des stratégies les plus couramment employées par les critiques et les érudits de l'Antiquité et de l'Âge moderne pour qualifier les œuvres figurées et pour les comparer entre elles. La critique littéraire a ainsi fourni de manière répétée un cadre théorique et une terminologie stylistique permettant de célébrer certaines œuvres d'art et certains artistes et d'en disqualifier d'autres. Après un premier volume consacré à l'usage des notions stylistiques dans le discours critique sur les arts, le présent ouvrage se propose d'étudier la façon dont certains artistes ont pu s'approprier les théories stylistiques et éventuellement y répondre par des œuvres programmatiques.Si les auteurs littéraires avaient la possibilité ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
21.80 €
Ajout au panier /
