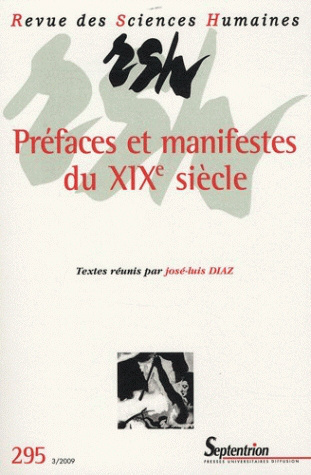
Revue des Sciences Humaines, n° 295/juillet-septembre 2009
Préfaces et manifestes du XIXe siècle
José-Luis DIAZDate de publication
1er janvier 2009Résumé
En matière de réflexions sur la littérature, le XIXe siècle est un siècle de mutations.La ruine de l'édifice des poétiques et des rhétoriques et la mise au pilori de ses mentors (Boileau, La Harpe, Marmontel...), a été le signal d'une constante " critique de la critique. Mais c'est précisément cette fin de non-recevoir opposée à la critique normative qui a entraîné une activité sans précédent de la réflexion théorique sur la littérature. Réflexion d'autant plus aiguë qu'elle était dans l'obligation de réinventer tous ses principes. Recherche passionnée d'un nouveau " pacte " esthétique, la " critique des créateurs " se fait active et multiforme. Elle s'exprime en particulier par la multiplication des préfaces, et plus encore des " préfaces-manifestes ". Loin de se conte ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
23.00 €
Ajout au panier /
