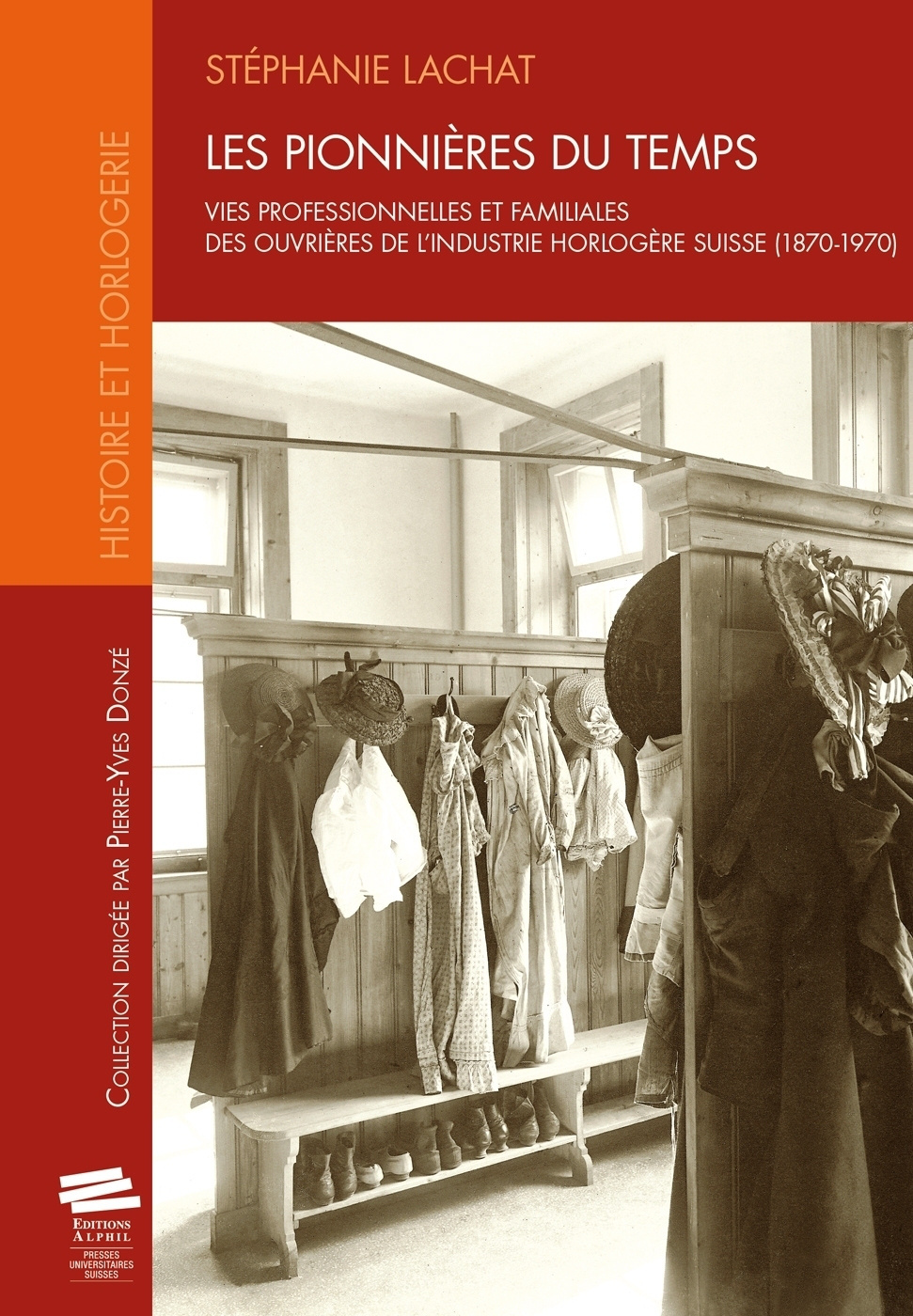Remerciements
Partie I : introduction
1 Questionnements
1.1 Une question d'actualité
1.2 Socio-histoire de l'articulation famille/emploi
1.3 Articulation famille/emploi : état du champ
2 Options théoriques
2.1 Approche de genre
2.2 Distinction privé-professionnel-public
2.3 Distinction travail/emploi
3 Terrain de recherche
3.1 L'horlogerie suisse
3.1.1 Les femmes dans l'horlogerie : un terrain idéal
3.1.2 Histoire et historiographie horlogères
3.1.3 Une industrie sous contrôle étatique
3.2 Acteurs et actrices
3.2.1 Les élites socio-économiques : dominante patronale
3.2.2 Les horlogères : à produit de luxe, ouvrières d'élite
3.3 Espace et temps
3.3.1 Saint-Imier
3.3.2 L'entreprise longines
3.3.3 Bornes temporelles : 1870-1970
4 Options méthodologiques : les nécessaires croisements
4.1.1 Histoire et sociologie
4.1.2 Pratiques et représentations
4.1.3 Jeux d'échelles
5 Sources
5.1 Sources écrites
5.2 Sources orales
5.3 Littérature, autobiographies, témoignages écrits
5.4 Iconographie
Pour entrer en matière
Partie II : portrait collectif des ouvrières de l'horlogerie
6 Sources et méthodes
6.1 Etudier les statistiques parce qu'elles construisent la réalité sociale
6.2 Se méfier des statistiques parce qu'elles reflètent les constructions sociales
7 Profil sociodémographique de l'emploi féminin horloger
7.1 Avant les fabriques : déjà des femmes
7.2 Combien sont-elles ?
7.2.1 Augmentation des effectifs féminins et féminisation de l'horlogerie
7.2.2 Tendance à la concentration des femmes en fabrique
7.2.3 Années 1920 et 1930 : effets des rationalisations et des crises
7.2.4 Trente glorieuses : retrait progressif des hommes de l'emploi horloger
7.3 Quel âge ont-elles ?
7.3.1 La césure des 25 ans
7.3.2 Années 1920 et 1930 : les femmes dans la force de l'âge résistent aux crises
7.3.3 Trente glorieuses : mobilisation des femmes entre 20 et 50 ans
7.4 Sont-elles mariées ?
7.4.1 Des horlogères " très mariées "
7.4.2 Années 1920 et 1930 : après 30 ans, les ouvrières célibataires sont minoritaires
7.4.3 Trente glorieuses : augmentation de la part des femmes mariées
7.5 Sont-elles mères ?
7.5.1 Contrôle volontaire des naissances
7.5.2 Longines, 1909 : beaucoup d'épouses, peu de mères, peu d'enfants
7.5.3 Trente glorieuses : baby-boom horloger
8 Les conditions de travail des femmes dans l'horlogerie
8.1 Forte division sexuée du travail : la fabrication en parties brisées
8.2 Formation horlogère restreinte pour les femmes : l'exception des régleuses
8.2.1 Les écoles d'horlogerie
8.2.2 Les classes de réglage pour jeunes filles
8.2.3 La régleuse et le régleur
8.2.4 Des compétences sans qualification
8.3 Salaires : des conditions meilleures qu'ailleurs ?
8.4 Les horlogères ne sont pas une " armée de réserve "
Conclusion partie II
Partie III : articuler famille/emploi. la logique de la double tâche
9 Les débuts du travail en fabrique : mise en place de la logique de la double tâche
9.1 Problèmes d'articulation renforcés par l'industrialisation : famille et emploi prennent leurs distances
9.1.1 La distance au sens propre : éloignement spatial
9.1.2 La distance au sens figuré : disciplinarisation du travail
9.2 Sphère familiale en mutation
9.3 A Saint-Imier, silences sur la " question sociale "
9.4 Peu d'opposition à l'emploi des horlogères
9.4.1 Quand la fabrique n'est bonne ni pour les femmes ni pour les hommes
9.4.2 Le travail des femmes comme moyen de lutte contre la pauvreté
10 Les trente glorieuses : renforcement du pôle domestique de la double tâche des ouvrières
10.1 Le plaisir des femmes à travailler
10.2 La fabrique comme famille
11 L'ouvrière-ménagère : le maintien des compétences ménagères
11.1 Fin du xixe siècle et début du xxe siècle : faciliter le domestique
11.1.1 L'externalisation des tâches domestiques
11.1.2 Les horaires de travail
11.2 Au fil du xxe siècle : rendre l'ouvrière efficace
11.3 La formation ménagère
11.3.1 Marquer la différence de classe
11.3.2 Favoriser l'articulation famille/emploi
12 L'ouvrière-mère : " mais que font-elles de leurs enfants ? "
12.1 Protection de la maternité : lois et conventions collectives
12.2 Jusqu'à la crise des années 1930 : des œuvres patronales pour lutter contre la misère sociale et sanitaire des enfants
12.2.1 La crèche
12.2.2 L'école enfantine
12.2.3 L'école gardienne
12.2.4 Les colonies de vacances
12.3 Trente glorieuses : une prise en charge minimale des grands enfants
12.3.1 Désintérêt patronal
12.3.2 Désintérêt social
12.3.3 Les arrangements entre femmes
12.3.4 De la crèche franc-maçonne à la crèche des entreprises
Conclusion partie III
Partie IV : le rapport à l'emploi des femmes. stratégies et contraintes des acteurs/trices
13 Le travail à domicile dans l'industrie horlogère : d'un mode de production contesté à une modalité d'articulation famille/emploi valorisée
13.1 Des efforts de définition pour organiser et contrôler les structures de production
13.2 Approche quantitative
13.2.1 Critique des sources
13.2.2 Les tendances lourdes d'un siècle de travail horloger à domicile : érosion, féminisation, déqualification
13.3 Fin xixe siècle et début xxe siècle : le travail à domicile objet de (presque) toutes les critiques : discours et pratiques des élites socio-économiques
13.3.1 Les élites préfèrent le travail horloger en fabrique à celui à domicile
13.3.2 La fabrique pour discipliner les milieux ouvriers
13.3.3 Le travail à domicile comme danger pour l'industrie horlogère
13.3.4 Limiter le travail horloger à domicile, le promouvoir dans d'autres branches
13.4 Trente glorieuses : le retour silencieux du travail à domicile
13.4.1 Du point de vue des employeurs : le travail domiciliaire comme modalité d'emploi
13.4.2 du point de vue des ouvrières : le travail domiciliaire comme modalité d'articulation famille/emploi
13.4.3 L'articulation famille/emploi " cachée " dans les foyers
14 A la recherche des " petites mains " : recrutement national et recrutement étranger
14.1 L'immigration dans le jura bernois à la fin du xixe siècle et au début du xixe siècle
14.2 Les migrations intérieures au service de l'industrie horlogère jurassienne
14.3 Ouverture progressive de l'industrie horlogère suisse à la main-d'œuvre étrangère
14.4 Réglementation spécifique du recrutement étranger dans l'horlogerie suisse
14.5 Les difficultés d'articulation famille/emploi pour les ouvrières italiennes
14.5.1 Les " italiennes " sont-elles mères ?
14.5.2 Le regroupement familial
14.5.3 Les 'italiennes' obligées de travailler en fabrique
14.5.4 L'engagement de la communauté italienne en faveur de la garde des enfants
Conclusion partie IV
Conclusions générales
Les trois axes d'analyse du rapport à l'emploi des femmes : nécessité, possibilité et représentations
A l'avenir
Annexes
Bibliographie