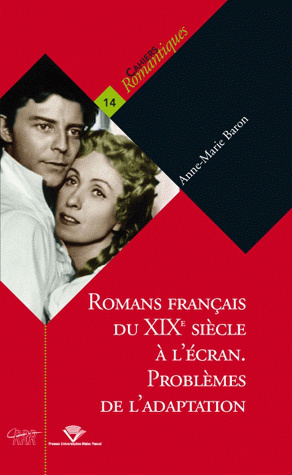
Romans français du 19e siècle à l'écran
Anne-Marie BARONCollection
Cahiers romantiquesDate de publication
16 juin 2008Résumé
La question de l'adaptation laisse trop souvent les enseignants désarmés, alors que souvent les étudiants ont d'abord accès aux romans du 19e siècle par le cinéma. La comparaison entre le texte et le film s'avère toujours un exercice fructueux, qui leur fait prendre conscience des contraintes propres à chacun des deux modes d'expression. Mais des préliminaires historiques et théoriques sont indispensables pour mener à bien cet exercice. Or les nombreux ouvrages parus ces dernières années sur l'adaptation ont été écrits par des théoriciens du cinéma dans un vocabulaire difficile d'accès pour les littéraires. Enseignants et étudiants ont besoin de démarches plus pratiques, mieux ciblées, et directement utilisables. Sémiotique et analyse littéraire, histoire de la littérat ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
24.00 €
Ajout au panier /
