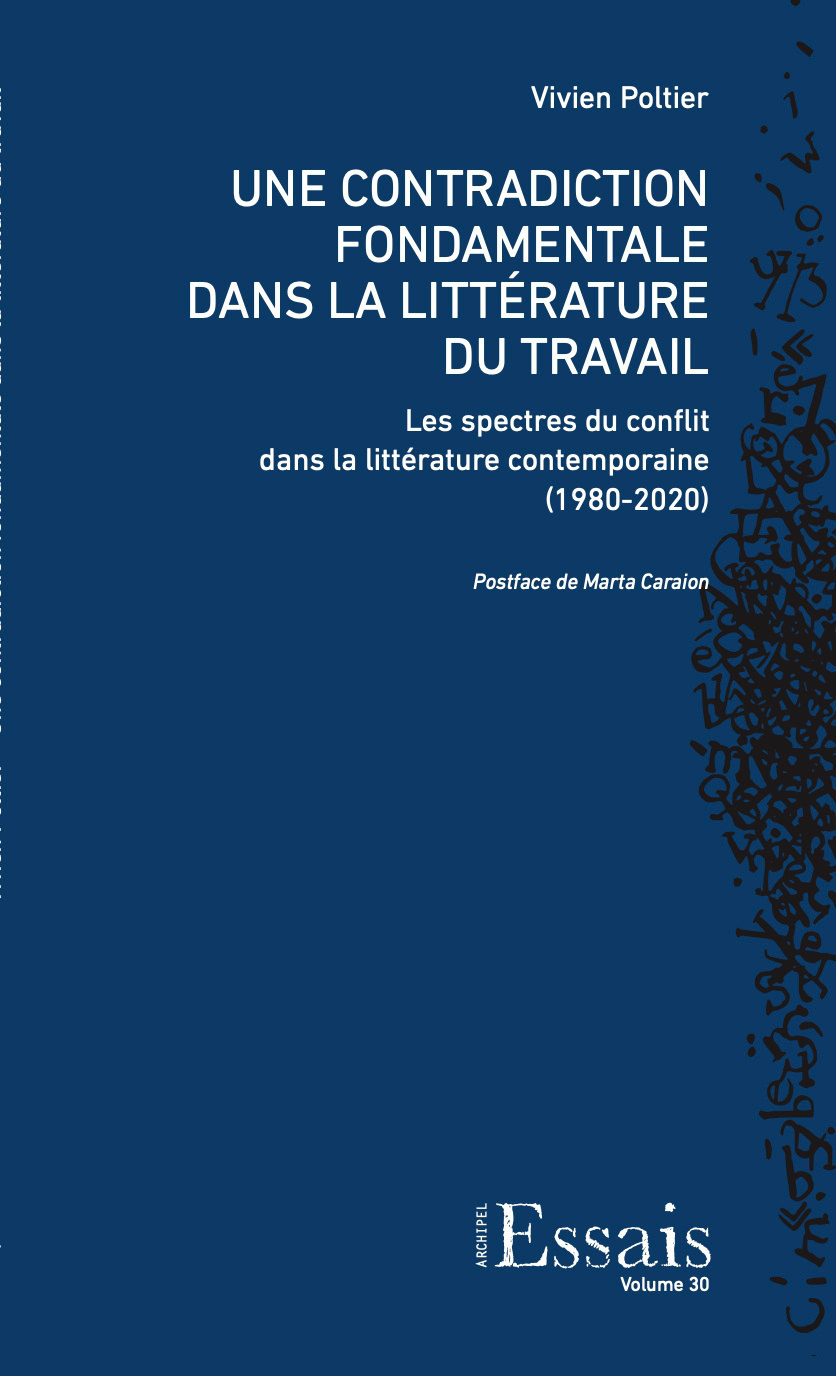Sommaire
Ouverture mallarméenne : les lignes invisibles de la séparation
Danger : l'enfermement spirituel ou scolastique
Séparation entre travail matériel et travail intellectuel
Pour Sainte-Beuve : une rechute biographique ?
L'opposition travail matériel/travail intellectuel : une matrice
spéculative
Le néolibéralisme, encore. L'engagement, encore
Une lecture matérialiste du travail matériel
1. Beauté de la misère et misère de la beauté dans
Les Fils conducteurs de Guillaume Poix
Inégalité ontologique des deux personnages focaux
Représenter les travailleurs et le lieu de travail : le problème
de l'extériorité radicale
Le " on " : subjectivité introuvable ou universelle ?
L'aveu autobiographique
L'esthétisation ou la disparition du travail réel
La langue de la bosse surmontera-t-elle l'obscénité ?
2. Les ambiguïtés du reportage social dans Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas
Le reportage face à la crise
De la naïveté bourgeoise à la prolétarisation réifiante
Les limites de l'expérience incarnée
Les impressions : la dimension phénoménologique du témoignage
Une digression sur le didactisme journalistique dans le
reportage
Une monstration autorisée des violences de l'exploitation
La complexité des travailleurs réels : entre fierté, nostalgie et
rêve d'ailleurs
3. Le revenu et le revenant : de l'Utopie à l'atopie dans Le Laminoir (1995) de Jean-Pierre Martin
Le protagoniste, le narrateur et l'auteur : la reconfiguration passionnelle du roman et la nécessité de la mise à distance
Troubles dans l'identité et dans la fiction
De la bibliothèque au manège : la négation de soi et la
pulsion sadomasochiste
Le côté obscur de la pulsion littéraire comme idéologie
De l'idéalité de principe au principe de réalité : la désaliénation
du prolétariat comme affabulation
L'intensité de l'existence ou la drogue de la jeunesse
L'effondrement de l'Idée politique face aux travailleurs heureux
Le réflexe testimonial comme mauvaise conscience ?
L'épilogue ou l'impossible réunification du sujet clivé ?
Conclusion
Bibliographie sélective
Postface par Marta Caraion