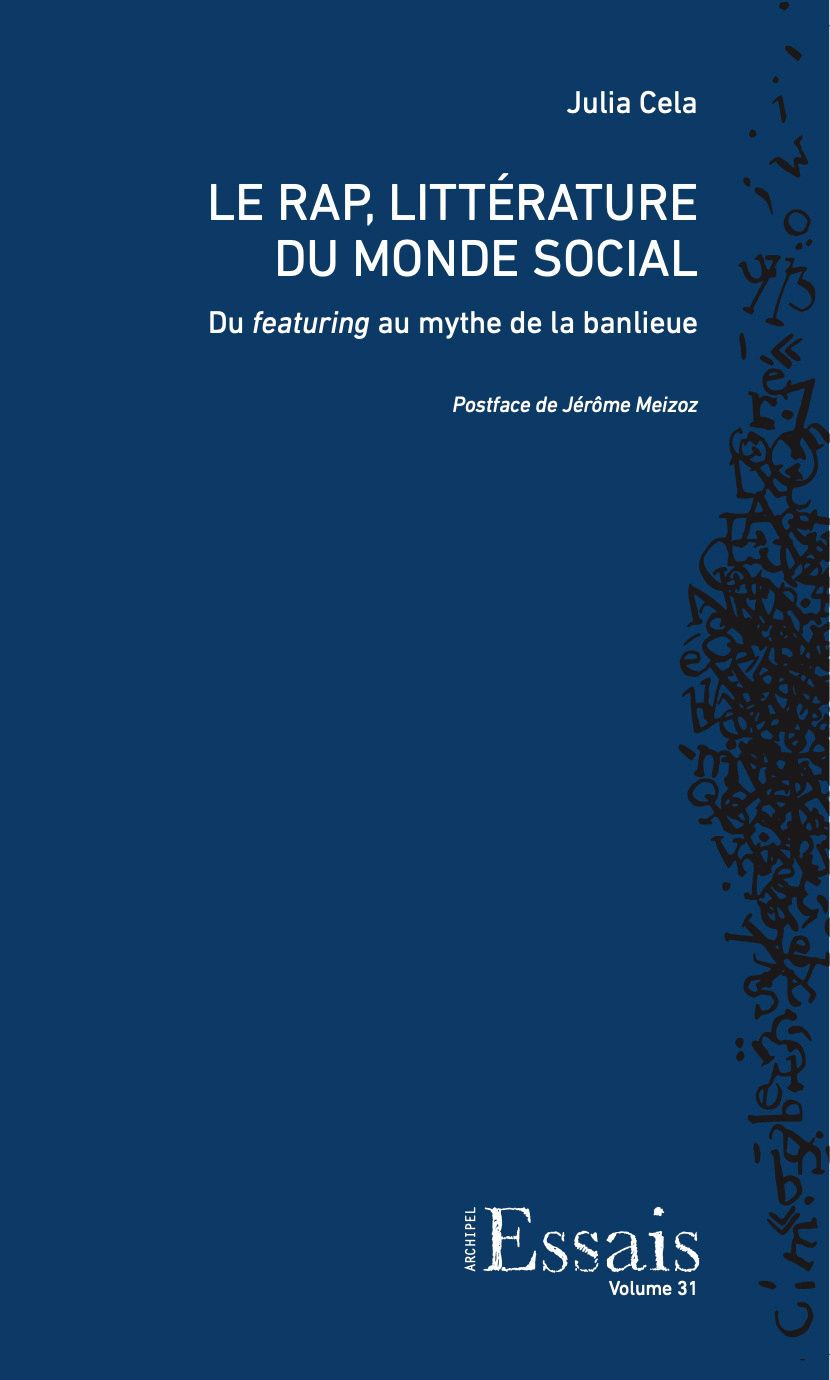
Rap, littérature du monde social.
Julia CELARésumé
Cet essai a pour première impulsion la volonté d'extraire le rap d'une réception orientée par la hiérarchie symbolique des objets culturels. La clé semble résider dans la manière dont les conditions sociales de l'émergence du genre dans la France des années 90, deviennent, dans les environs de 2015, des motifs textuels qui dessinent les traits de sa poétique et de son esthétique. L'exemple le saillant de cette translation est le featuring. Consistant à inviter un·e·x autre artiste·x à collaborer sur un même morceau, ce phénomène représente l'unité de base des chaînes de coopération qui ont permis l'institutionnalisation du rap à ses débuts. Aujourd'hui, le featuring apparaît dans les textes comme la marque d'un regard sociologique porté par le rap sur sa propre histoire ...
Lire la suite
FORMAT
Livre relié
14.00 €
Ajout au panier /
