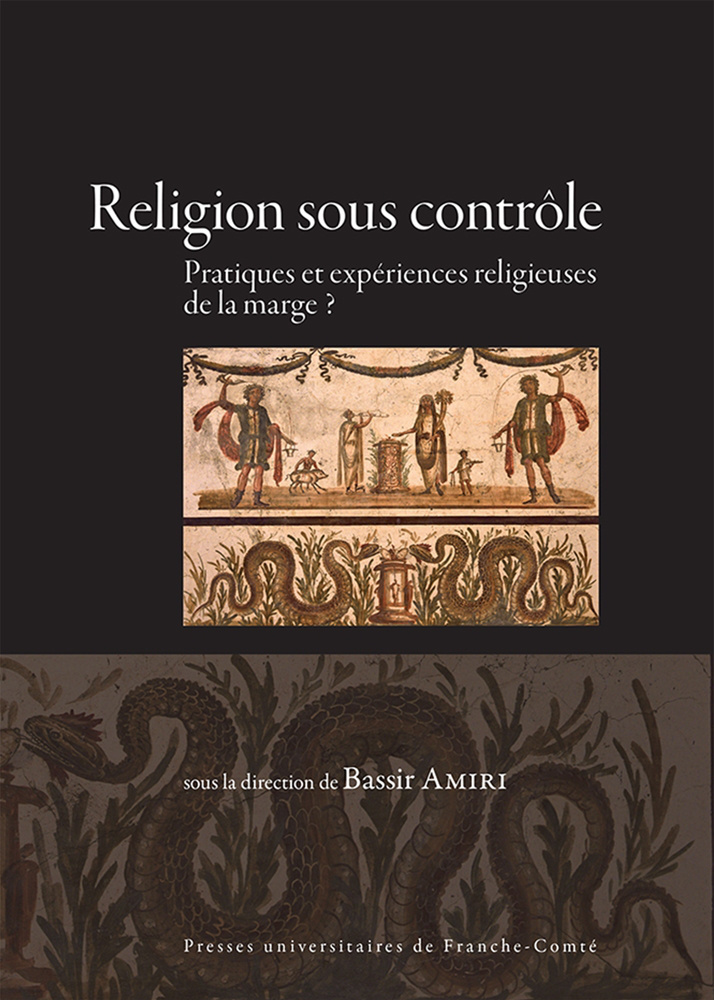
Religion sous contrôle
Bassir AMIRIDate de publication
20 septembre 2016Résumé
L'ouvrage étudie, pour Rome et certaines de ses provinces occidentales, les expériences religieuses des individus (femmes, esclaves, affranchis, dévots de cultes dits étrangers) dont le statut et les choix les exposent souvent à des phénomènes d'exclusion. Il interroge la place qu'ils occupent dans les faits religieux de la cité pour mettre en valeur les ponts jetés entre les différents espaces communautaires à l'occasion des actes cultuels et pour réévaluer la portée des gestes accomplis par ceux dont la situation leur refuse a priori le premier rôle. Quoique bien encadrées, leurs pratiques, effectives, leur confèrent une capacité religieuse, qui mérite en effet d'être définie.
FORMAT
Livre broché
22.00 €
Ajout au panier /
