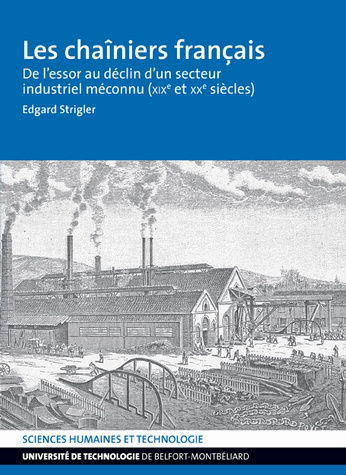
Les chaîniers français
De l'essor au déclin d'un secteur industriel méconnu (XIXe et XXe siècles)
Edgard STRIGLERCollection
Sciences humaines et technologieEditeur
Pôle éditorial de l'UTBMDate de publication
28 janvier 2013Résumé
L'industrie française de la chaîne démarra en 1823 lorsque la Marine décida de construire un atelier pour produire des chaînes de mouillage aux Forges de la Chaussade à Guérigny dans la Nièvre. Parallèlement des ateliers petits et grands se créèrent pour fournir la marine marchande. Cet ouvrage décrit l'essor des deux districts de Saint-Martin-la-Plaine dans la région stéphanoise et de Saint-Amand-les-Eaux dans le Valenciennois. Le premier ne dépassa pas le stade de la proto-industrie tandis que la mécanisation progressa dans les chaîneries amandinoises avec l'adoption de la soudure électrique accompagnée du passage du fer à l'acier.Les difficultés à assurer des soudures par forgeage de qualité suffisante suscitèrent l'innovation, où s'illustra Galle après Vaucanson. Le ...
Lire la suite
FORMAT
Produit proposé à la vente en plusieurs composants
31.00 €
Livre broché
29.00 €
Ajout au panier /
