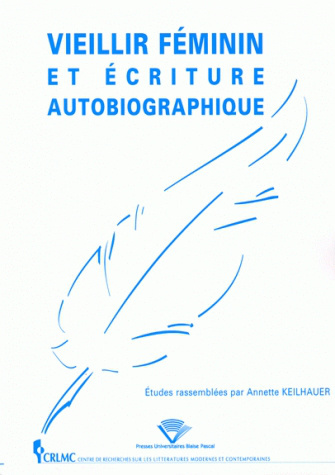
Vieillir féminin et écriture autobiographique
Annette KEILHAUERDate de publication
1er janvier 2007Résumé
Dans le corpus de l'écriture autobiographique féminine, du 19e au 21e siècle, on observe une convergence particulière d'aspects anthropologiques, de traditions littéraires et de témoignages individuels. Les femmes qui écrivent sur leur propre vie se trouvent dans une situation de double décalage par rapport à la tradition littéraire. D'une part, la méfiance portée à la production artistique féminine jette le doute sur la sincérité de la femme autobiographe. D'autre part, il existe jusqu'au 20e siècle un discours social et culturel qui condamne la femme vieillissante en se focalisant presque exclusivement sur la perte de sa beauté physique et de sa fertilité. Or les spécificités de production et de publication de l'écriture féminine, en particulier de l'écriture autobiog ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
20.00 €
Ajout au panier /
