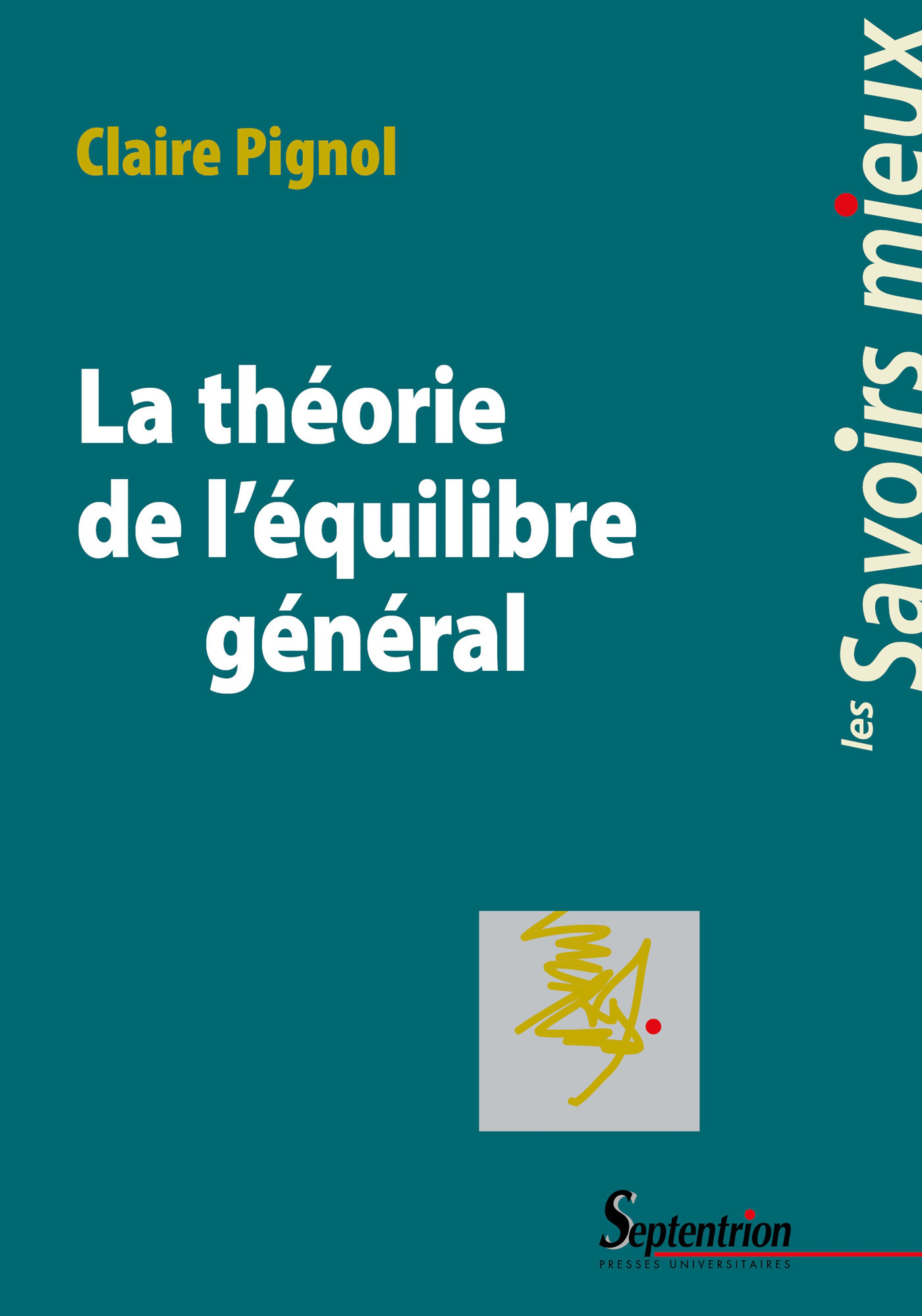
Théorie de l'équilibre général
Claire PIGNOLCollection
Savoirs mieuxDate de publication
22 mars 2017Résumé
Des agents qui décident indépendamment les uns des autres peuvent-ils coordonner leurs activités ? Depuis le XVIIIe siècle, la pensée économique répond à l'aide d'une intuition : une coordination est possible grâce au mécanisme des prix. La théorie de l'équilibre général explore cette intuition. Elle établit les conditions dans lesquelles des prix existent tels que les décisions individuelles sont compatibles entre elles. Elle constitue ainsi la théorie d'une société qui conçoit sa cohérence à partir des choix des individus qui la composent.Toutefois, la théorie de l'équilibre général a produit sa propre critique. L'examen du processus concurrentiel, tout comme l'ambition de déduire un choix social à partir des préférences individuelles, réduisent la portée de ses résul ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
13.00 €
Ajout au panier /
