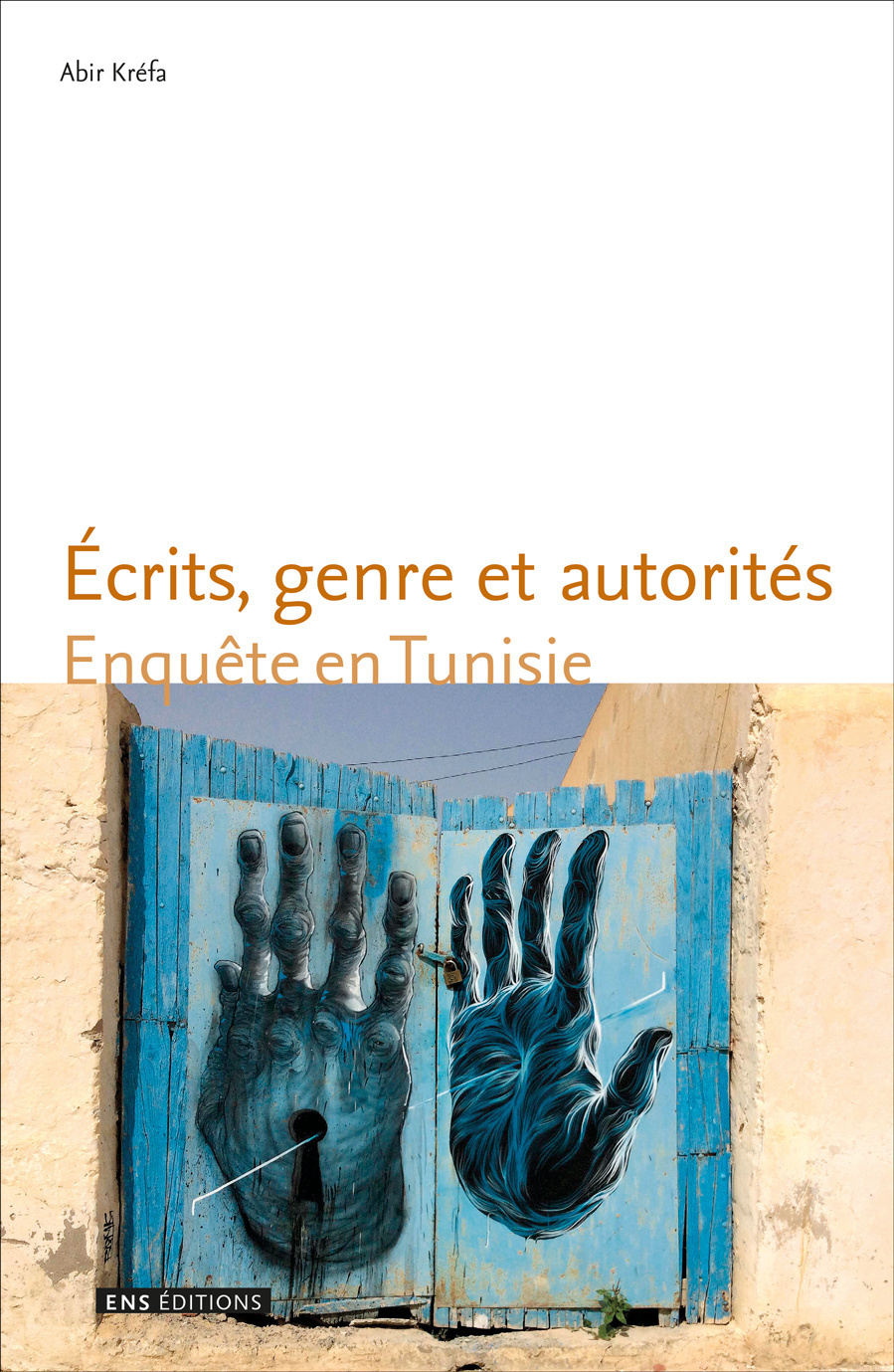Notes sur la traduction et la translittération
Lexique des mots en arabe
Sigles et abréviations
Introduction
Partie 1 : Des pratiques risquées
Chapitre 1 : Fictions d'une spécificité
Dispositifs d'assujettissement et contestations ;
La promotion des " élites féminines " comme moyen de légitimation ;
Capital scolaire, production des élites et frontières sociales ;
Chronologie politique.
Chapitre 2 : Un marché récent et étroit
Un univers éditorial émergent ;
Une aspiration à la professionnalisation ;
La diversification des revenus ou la sortie du milieu.
Chapitre 3 : Censure, subventions et sanctions
Une institution judiciaire faiblement mise à contribution ;
Rouages bureaucratiques ;
Incitations et sanctions économiques.
Partie 2 : Des écritures ordinaires aux écritures littéraires
Chapitre 4 : La venue à l'écriture
Une socialisation lectorale et orale intense et précoce ;
La classe des événements et des contextes ;
Élection, sentiment de singularité et estime de soi.
Chapitre 5 : La diversité des héritages
La variation des origines socio-géographiques ;
Famille restreinte et famille élargie ;
Des imams, cheikhs et ulémas aux écrivains contemporains .
Chapitre 6 : L'école de l'écriture : titres, appétences et compétences
Des écrivains et écrivaines issus des élites scolaires ;
Les intellectuels de " première génération " : des transfuges " structurels " ?
La reconnaissance précoce de l'institution scolaire.
Chapitre 7 : Le temps, la famille et l'argent
Rêve inaccessible et autonomie artistique ;
Activités littéraires, négociations et ruptures conjugales ;
" Conciliations " ou tensions identitaires ?
Partie 3 : Résistances et aspirations à la reconnaissance
Chapitre 8 : Misère de position et quête de reconnaissance
Un capital social indispensable et fragile ;
Des victimes structurales des hiérarchies littéraires internationales ;
Les écrivaines aux prises avec une catégorie ségrégative.
Chapitre 9 : Résister en contexte autoritaire
La continuation du militantisme par d'autres moyens ;
La politisation de la censure ;
La quête de l'autonomie littéraire.
Chapitre 10 : L'écriture du corps entre injonctions des pairs et censure disséminée
Le corps féminin dans tous ses états ;
" L'audace " comme catégorie d'appréciation des œuvres ;
La proscription privée de l'expression du corps ;
Déjouer les injonctions contradictoires.
Conclusion
Références bibliographiques
Documents de travail
Œuvres littéraires
Témoignages
Critique littéraire
Autres