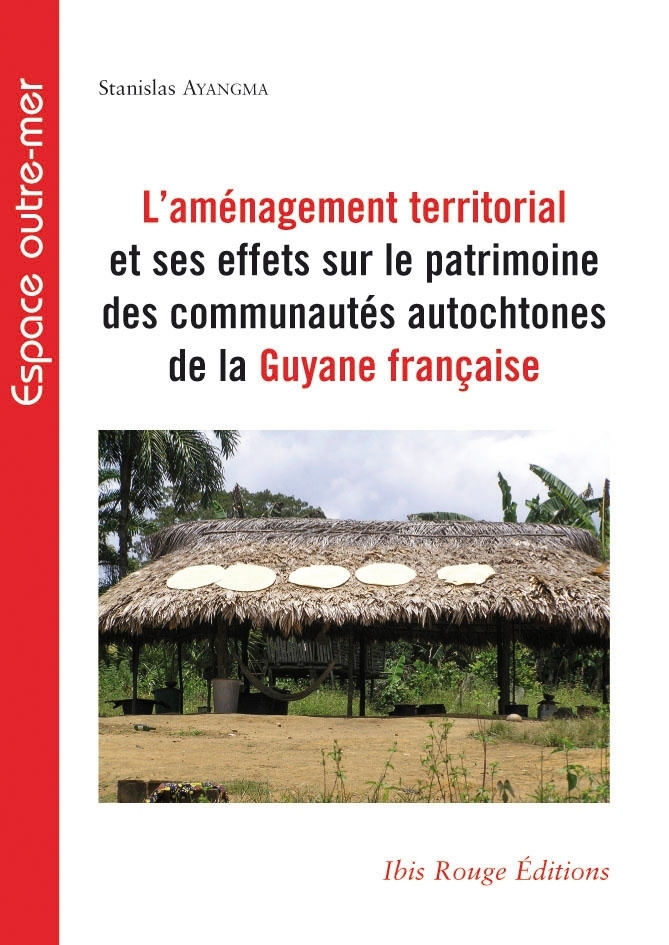
L' Aménagement territorial et ses effets sur la patrimoine des communautés autochtones de la Guyane française
Stanislas AYANGMARésumé
La Guyane française demeure jusqu'en 1946 une marge coloniale marquée par les échecs successifs des projets de développement. La départementalisation qui est alors mise en place, permet à l'État d'engager un aménagement territorial de la Guyane qui, au début des années 1980, a eu pour corollaire la capture sociospatiale des communautés locales côtières. Les communautés amérindiennes du sud, épargnées en partie par cette évolution, parviennent à maintenir leur patrimoine adossé culturellement au milieu amazonien. Alors que les limites du projet assimilationniste engendrent une crise sociale et structurelle, la conquête de l'intérieur est relancée et devient un enjeu de pouvoir entre les collectivités décentralisées et l'État. L'avènement du développement durable au début ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
40.00 €
Ajout au panier /
