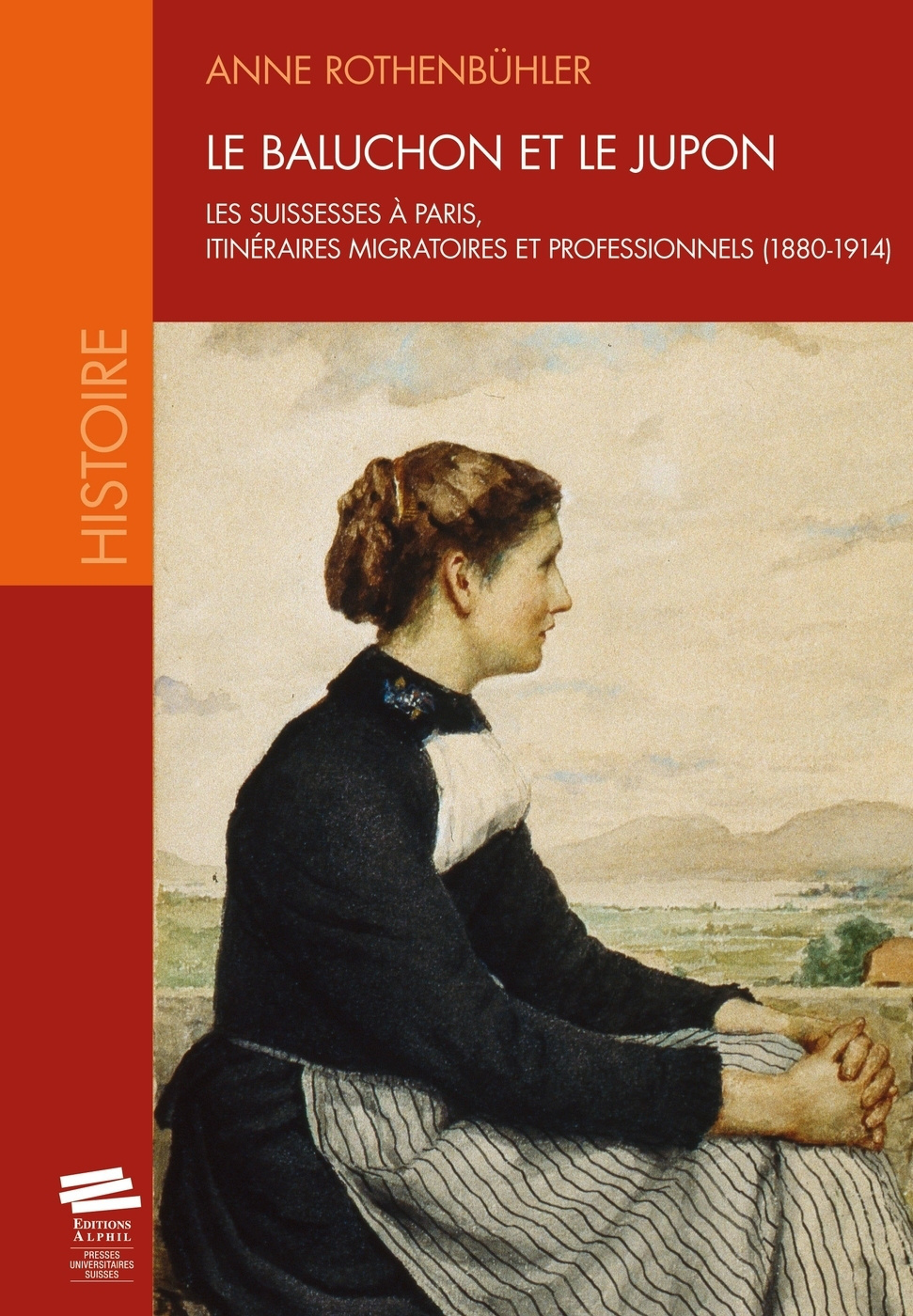Introduction générale
Première partie : Penser le départ
Chapitre 1 : Suisses en migration
I. Une terre ancienne d'émigration ;
A. Les échelles de la mobilité ;
B. Formes ;
C. Structures et organisation ;
II. Les Suissesses : L'émigration oubliée ? ;
A. Les préceptrices suisses : une migration de type traditionnel (1815-1880) ;
B. Des bonnes-à-tout faire à Paris : une migration d'un type nouveau ? (1880-1920) ;
C. Les chemins vers Paris.
Chapitre 2 : Les lieux de départ
I. La Suisse romande, terre de contrastes ;
A. Julia L. de Cornol en Ajoie ;
B. Marie M. de Montreux ;
C. Alphonsine L. née à Salvan en Valais ;
II. Le marché du travail féminin en Suisse romande ;
A. Education et formation des Suissesses (1815-1890) ;
B. De nouveaux métiers féminins ;
C. Etre domestique en Suisse à la fin du XIXe .
Chapitre 3 : Discours et pratiques : la Romande dans l'espace public
I. Le philosophe et le médecin : théoriciens de l'infériorité féminine ;
A. De la faiblesse physique de la femme ;
B. La femme : un être influençable ;
II. Exister dans l'espace public grâce aux associations féminines ;
A. La maternité sociale : du foyer à la nation ;
B. Les différents domaines d'action ;
C. Petite histoire de l'action féminine en Suisse (1800-1900.
Deuxième partie : Fragments de vie parisienne
Chapitre 4 : Paris : capitale de l'immigration féminine
I. Les migrantes étrangères à Paris : dénombrement et comparaison ;
A. Sources et méthode ;
B. Du nombre d'hommes et de femmes dans les quatre colonies choisies ;
II. Lieux de vie et espaces du quotidien ;
A. Un espace de vie sexué ? Deuxième essai de typologie ;
B. Spécificité de la migration des Suissesses.
Chapitre 5 : Migrantes au travail
I. Travailler à Paris ;
A. La chambre, l'atelier et la rue : les espaces de travail des migrantes ;
B. Des professions mixtes ;
II. De la condition domestique ;
A. La réputation. Un critère de distinction sur un marché du travail tendu ;
B. Etre domestique à Paris dans le dernier tiers de XIXe.
Chapitre 6 : Contrôler et réguler : la colonie suisse de paris
I. Une communauté très encadrée ;
A. Les Suisses de Paris : profil d'une colonie ;
B. " Monsieur le Ministre " ;
C. Une colonie actrice de sa réputation ;
II. Le poids des associations ;
A. Des associations nombreuses et variées ;
B. La Société Helvétique de Bienfaisance ;
III. Contraindre et discipliner le corps ;
A. Au chevet des migrantes ;
B. Soigner et punir : les " bonnes œuvres " des Diaconesses.
Chapitre 7 : Penser le retour
I. Des configurations contrastées ;
A. Etre domestique à Paris : une étape ? ;
B. Immigrer pour accoucher ;
II. Les tourments de la migration ;
A. Les difficultés rencontrées ;
B. Organiser le retour.
Conclusion générale