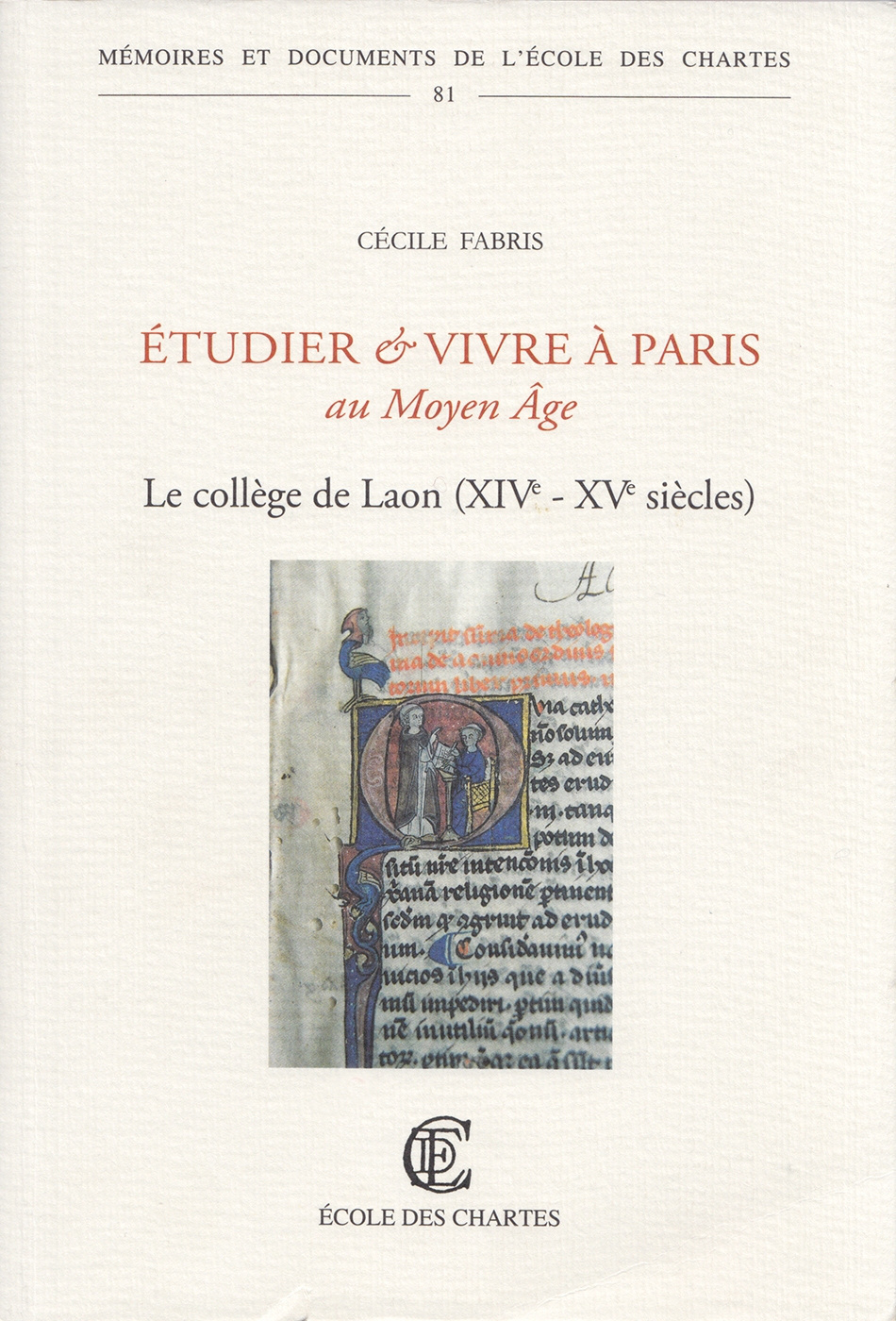
Étudier et vivre à Paris au Moyen Âge
Cécile FABRISEditeur
École nationale des chartesDate de publication
1er juillet 2005Résumé
L'étude des collèges a participé au renouvellement des connaissances sur l'Université au Moyen Age, qui bénéficie désormais de questionnements plus diversifiés. Mais les monographies restaient rares, en particulier pour les " petits collèges " alors que l'étude de ce type d'institution ouvre une voie prometteuse. La maison des écoliers de Laon - établissement sous tutelle de l'évêque de Laon - fait partie aux XIVe et XVe siècles de ces établissements parisiens de taille moyenne, sans rôle politique particulier, tournés essentiellement vers leur mission universitaire et la gestion du patrimoine qui leur permet de la remplir. Le cas de ce collège est d'autant plus intéressant que l'établissement peut être considéré comme emblématique, malgré sa taille - ou peut-être grâce ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
35.00 €
Ajout au panier /
