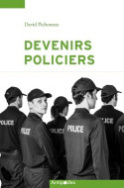Introduction
Prolonger les travaux sur la socialisation policière
- Le paradigme de la "culture policière" et ses défauts - Approcher la socialisation par l'habitus: éviter les pièges de la "culture" - L'habitus antérieur: des dispositions sociales "importées dans la police
La doxa professionnelle: un concept complémentaire à celui d'habitus
- La définition légale de la police - Le community policing: une hétérodoxie radicale
Comment appréhender sociologiquement l'objet "police" ?
Un groupe professionnel comme les autres ?
- Le débat autour de la centralité de la violence - La police, un sous-champ au sein du champ administratif
Données d'enquête
Structure de l'ouvrage
Comment travaille le "bon" ou la "bonne" policière?
La remise en cause du coeur de la doxa professionnelle
- Un métier "relationnel" ? - Hiérarchiser les tâches et les moyens d'action
"Méchants" ou "zigotos"? L'enjeu du rapport à l'autre
Conformisme et capacité de discernement: l'enjeu de l'autonomie réflexive
Pessimisme social et rapports aux migrations: l'enjeu de la vision du monde
Conclusion
La formation comme outil de réforme? Les obstacles de la violence et de la militarité
La nouvelle formation policière: un modèle atypique et hybride
- Une formation atypique - Des savoirs importés pour changer la police: les matières "réformatrices"
La mise à la marge des matières réformatrices
- Un plan d'études dominé par les matières traditionnelles - La force symbolique des spécialistes de la violence
La violence au coeur de la formation
- La méfiance, effet indésirable de la violence - Des corps intouchables?
L'encadrement officiel de la force policière: des prescriptions ambiguës
- La "parole" comme "arme": un concept ambigu - S'imposer sans agresser: un impensé de la formation - Enseigner la transgression des prescriptions officielles ?
Discipline et esprit de corps: la militarité de la formation policière
- Les contradictions entre discipline et non-conformisme - L'esprit de corps et le culte du secret: une association impensée
Conclusion
Combattre les "méchants"? Trajectoires sociales et investissement politico-moral dans le métier
Le prestige d'un métier singulier et de la "lutte contre la délinquance"
- Un rapport à l'autre fondé sur une distinction sociale et morale - "Nous" contre les "délinquants" - "Faire la morale" pour répondre au "laxisme judiciaire" - Résister aux prescriptions scolaires pour appartenir au groupe
Parler "d'égal à égal avec les justiciables: une réussite sociale fondée sur du capital scolaire ou social
- Une ascension sociale antérieure : le rôle du capital scolaire - Une ascension sociale antérieur e: le rôle du capital social
Conclusion
Goût pour le pouvoir et rapport à la violence. Le poids de la socialisation de genre
Masculinité virile et orthodoxie policière: le goût du pouvoir
Socialisation féminine et masculinité moins virile: la relation au centre?
Violence et agressivité : deux caractéristiques masculines
Masculinité virile et habitus hétérodoxe: des aspirations atypiques
Conclusion
Devenir pessimiste, raciste et autoritariste? L'impact du métier sur les visions du monde des recrues
Un ordre social menacé ?
Les ressorts du pessimisme policier
Qui menace l'ordre social ?
La racialisation des comportements délinquants
- Police et migrant·e·s: entre soupçon professionnel et rejet sociétal - Le "profilage racial" comme une évidence - Des recrues racistes ?
Comment rétablir l'ordre ?
Rapports différenciés aux solutions répressives
- "Justice laxiste" et insatisfactions professionnelles - Se préoccuper ou non de "ce qui se passe après"
Conclusion