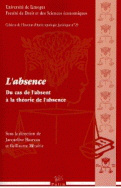
Absence
Jacqueline HOAREAU-DODINAU,Guillaume MÉTAIRIEDate de publication
31 octobre 2011Résumé
Les absents ont toujours tort. Le proverbe l'affirme ; moins univoque, le droit, apporte depuis longtemps ses tempéra-ments aux certitudes de la sagesse populaire en distinguant — en raison de la complexité des problèmes soulevés comme de la variété des solutions possibles — l'absence méritoire de celle jugée répréhensible d'une part, et d'autre part de la disparition simplement involontaire voire accidentelle. L'ancien droit n'a connu que des absents et n'a donc traité que des cas d'absence renvoyant à la période des codifi-cations napoléoniennes l'élaboration d'une théorie générale de l'absence que la tourmente révolutionnaire n'avait sans doute pas rendu inutile. Il faudra attendre le Code civil pour bénéficier d'une théorie générale de l'absence, née des troubles en ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
30.00 €
Ajout au panier /
