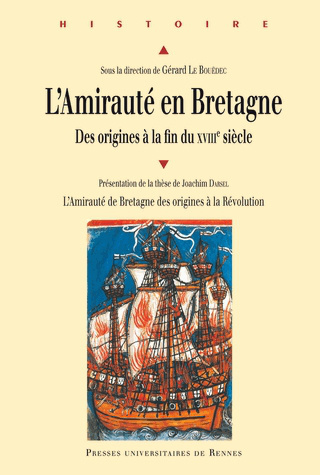Contextualisation XIIIe-XVIIIe siècle et évolution de l'historiographie maritime bretonne des années 1950 à nos jours
Thèse de Joachim Darsel
L'Amirauté de Bretagne des origines à la Révolution. La politique maritime des ducs de Bretagne du XIIIe au XVIe siècle
La Bretagne ducale
La Bretagne, province française, entend conserver son amirauté
Le Gouverneur de la province l'emporte sur l'Amiral du royaume
Les amirautés en Bretagne au XVIIIe siècle
A l'origine l'amirauté correspond à la fonction d'amiral, c'est-à-dire de commandant temporaire d'une armée navale, avant de devenir un juridiction particulière des questions maritimes et littorales administrant, réglementant et jugeant au criminel et au civil. L'amiral de France ne devient grand officier de la couronne qu'en 1342, mais avec une autorité réduite aux côtes normandes et picardes de l'île de France. En effet, en Provence, Guyenne et Bretagne existent des amiraux particuliers. la couronne ducale, qui conserva la mainmise sur l'administration de la marine bretonne, la police de navigation et les armements en guerre, ne fait de l'amiral de Bretagne un officier ducal qu'à la fin du XIVe siècle. Lors du rattachement de la Bretagne à la France, le roi de France tente en vain d'intégrer l'amirauté de Bretagne dans l'Amirauté de France, mais il doit se résoudre à accepter le cumul de la fonction d'amiral par le gouverneur de la Province. C'est par ce biais que Richelieu peut mettre très temporairement la main sur l'amirauté de Bretagne. C'est ce même subterfuge qui permet en 1695 de mettre fin à l'amirauté de Bretagne détenue par le gouverneur, le duc de Chaulnes, en nommant le fils de louis XIV, le comte de Toulouse, amiral de France, gouverneur de Bretagne. Mais jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les affaires maritimes bretonnes ne relèvent pas d'institutions spécifiques maritimes mais des juridictions ordinaires. C'est avec la mise en place, à partir de 1691, de sept circonscriptions d'amirauté, instruments de la mainmise de l'État royal sur le littoral, que se développe une juridiction extraordinaire dont la compétence est très large.Professeur d'Anglais en Bretagne puis à Paris, Joachim Darsel (1905-1974) soutient à Paris, en 1954, sa thèse sur L'Amirauté de Bretagne, des origines à la Révolution de 1789. C'est ce travail qui est aujourd'hui publié. l'édition de cette thèse très juridique et administrative, rédigée exclusivement à partir des sources parisiennes, jamais publiée, mais pourtant souvent citée dans les bibliographies sur la Bretagne et la France littorales, s'accompagne d'une mise à jour bibliographique et historiographique, d'une présentation du contexte sur l'objet même de la juridiction de toute amirauté à savoir les activités et les hommes du littoral et de la mer, et de cette dernière partie sur les amirautés du XVIIIe siècle que l'auteur lui-même avouait avoir négligée avant d'y consacrer, durant vingt ans, de nombreux articles en élargissant son territoire d'investigation aux amirautés de la Normandie où il termina sa carrière. Ce travail d'édition et d'enrichissement scientifique est le fruit de la collaboration d'une équipe dirigée par Gérard le Bouëdec.