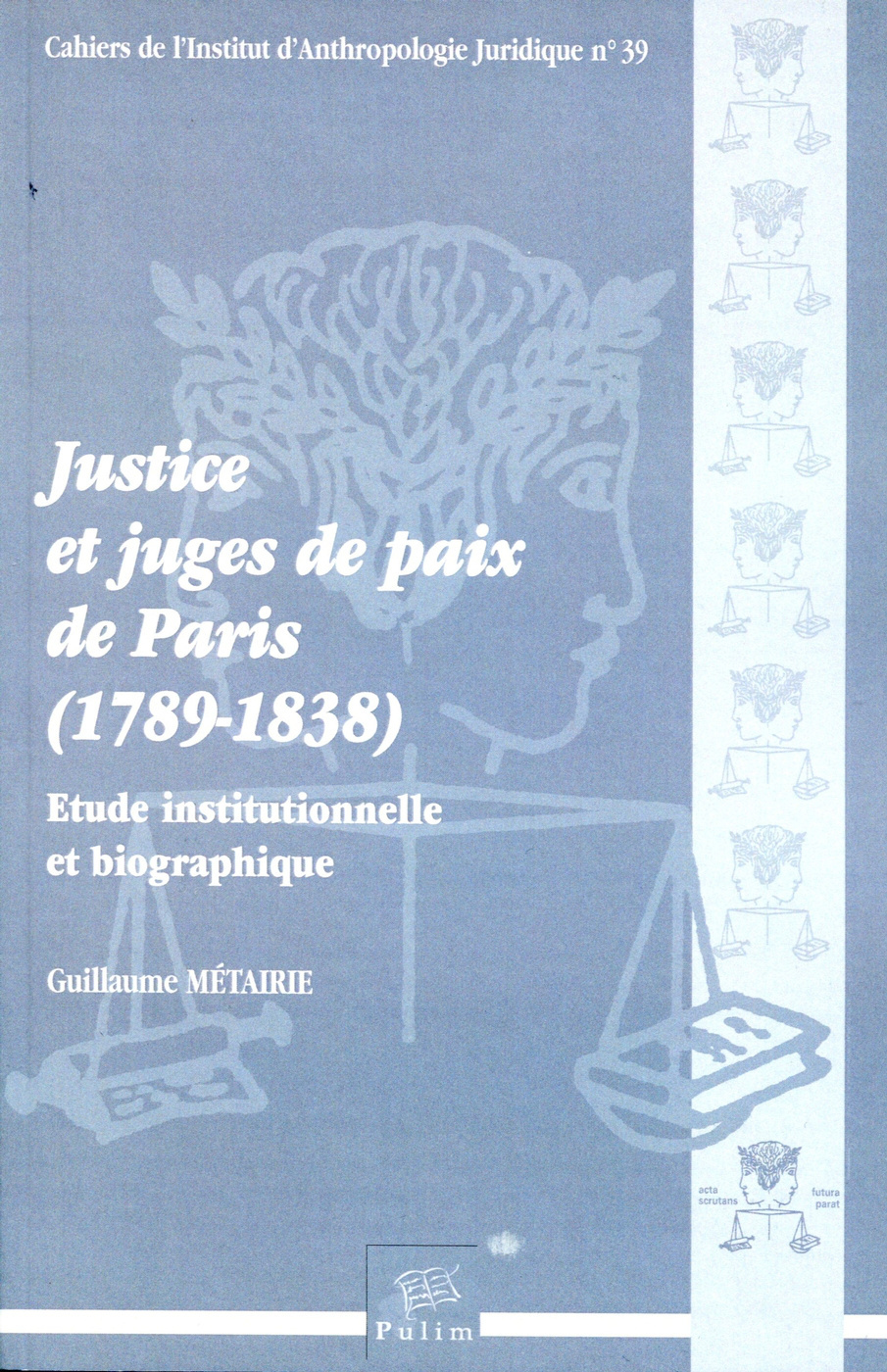
Justice et juges de paix de Paris (1789-1838)
Guillaume MÉTAIRIEDate de publication
24 novembre 2014Résumé
Depuis des années – voire des décennies – la Ve République tente de rétablir des conciliateurs de proximité. Peut-être eût-il été plus simple pour elle de ne pas supprimer, d'emblée, les juges de paix hérités de la Révolution française et, au-delà, d'une pratique séculaire de la Monarchie. Profondément enracinés à travers le pays, justice et juges de paix – magistrats d'un type spécifique parce que chargés d'incarner une conception neuve de la jurisdictio (d'accommodement désormais, plus que de jugement contentieux) – avaient su rendre d'inestimables services aux justiciables, tour à tour sujets ou citoyens d'un pouvoir politique qui peinait, quelle que fût sa forme, à renoncer au principe si commode à tous les gouvernants et qu'avaient énoncé, dès le Moyen Âge, les lég ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
50.00 €
Ajout au panier /
