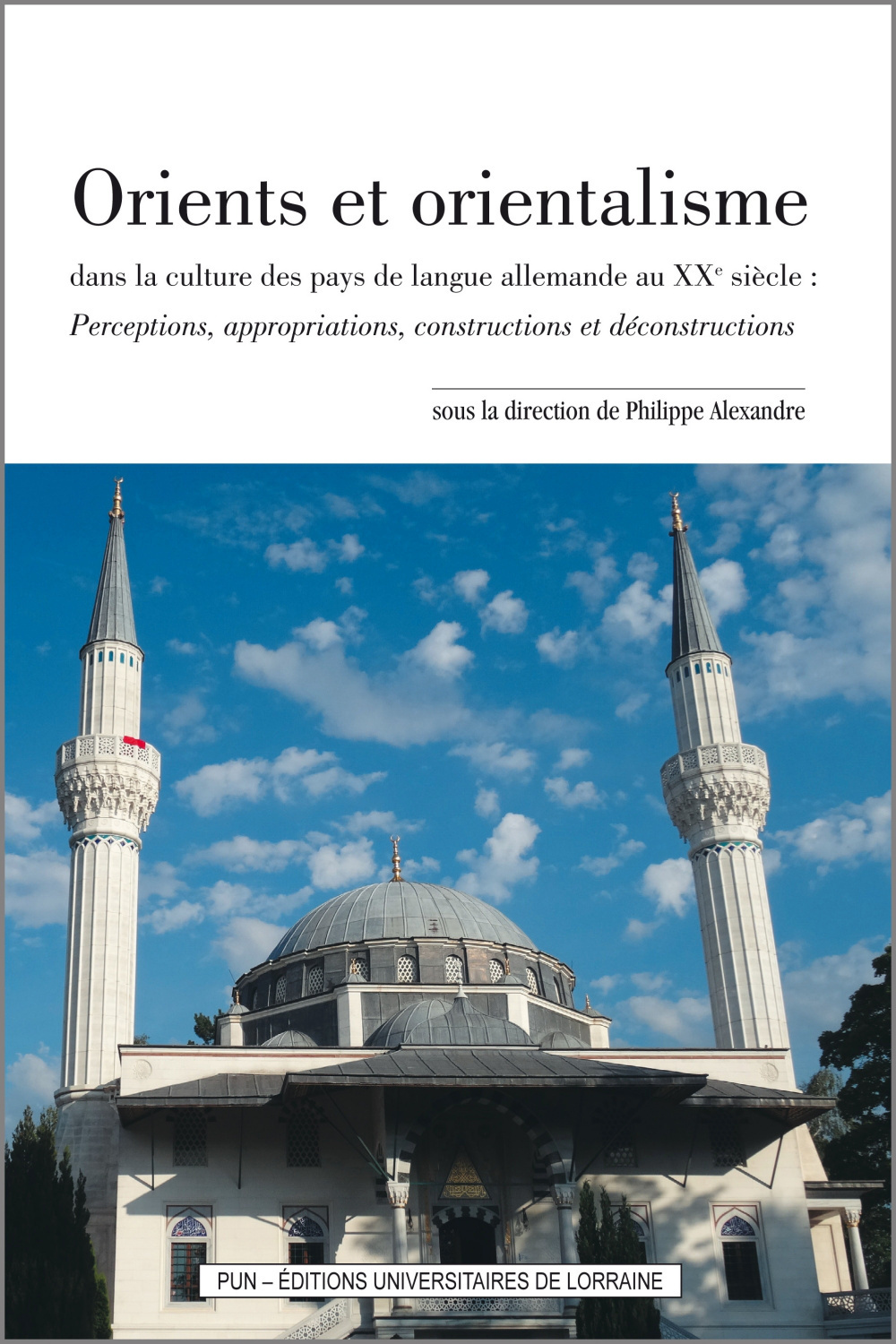Philippe Alexandre - Introduction
Opinions publiques
Philippe Alexandre – L'Allemagne et la " question chinoise ", 1897-1914. Éléments de réflexion sur l'impérialisme allemand à l'époque de Guillaume II ;
Clémence Andréys – Continuités et discontinuités dans l'image de la Chine en Allemagne pendant la République de Weimar ;
Paul Hoser – Das Bild der neuen Türkei in der deutschen Presse ;
Annie Bourguignon – Regards scandinaves sur l'Afghanistan.
Images et fictions (République de Weimar)
Julie-Anne Demel – Das orientalische Element in der Geschichte von der 1002. Nacht von Joseph Roth ;
Frédéric Teinturier – L'Orient dans l'œuvre de Lion Feuchtwanger : une présence centrale ;
Michel Vanoosthuyse – Orient, voyage retour. À propos de Voyage babylonien d'Alfred Döblin ;
Annie Lamblin – L'Orient dans le roman Die Blendung d'Elias Canetti.
Histoire des idées et pratiques esthétiques
Jean-Marie Paul – L'Orient de Schopenhauer et Eduard von Hartmann : conversion ou habillage ?
Christine Maillard – L'anti-japonisme d'une voyageuse européenne à la fin de l'Époque de Meiji : Anti-Japan et Die steinerne Geisha (1911) de Myrra Tunas ;
Philipp Menger – Östliches Kolorit und glühende Sonne. Orientalismus in der deutschen Oper im 20. Jahrhundert am Beispiel von Richard Strauss' Salomé ;
Gabriele Fois-Kaschel – Die Unvergleichlichkeit der asiatischen Tanzkunst für die literarische Moderne.
Écritures contemporaines
Linda Koiran – Nordkoreanisches Reisetagebuch (1981) de Luise Rinser : un espace " hétérotopique " ;
Catherine Repussard – Christian Kracht, Der gelbe Bleistift, Reisegeschichten aus Asien (2002). Entre nostalgie coloniale et mélancolie postcoloniale ;
Aurélie Choné – Asiatische Absencen (2008) de Wolfgang Büscher : un regard postmoderne et post-colonial sur l'Asie dans un monde globalisé ;
Myriam Geiser – Déconstructions d'orientalismes dans l'écriture de la post-migration : Zafer Senocak, Feridun Zaimoglu, Yadé Kara et Sherko Fatah ;
Christine Meyer – Guerres esthétiques et conflits communautaires. Le roman d'artiste comme riposte au " choc des civilisations " (Orhan Pamuk, Rafik Schami, Metin Arditi) ;
Karin E. Yesilada – Sufismus – ein neuer Islam-Diskurs ? Lektüren deutschsprachiger Gegenwartsautoren.