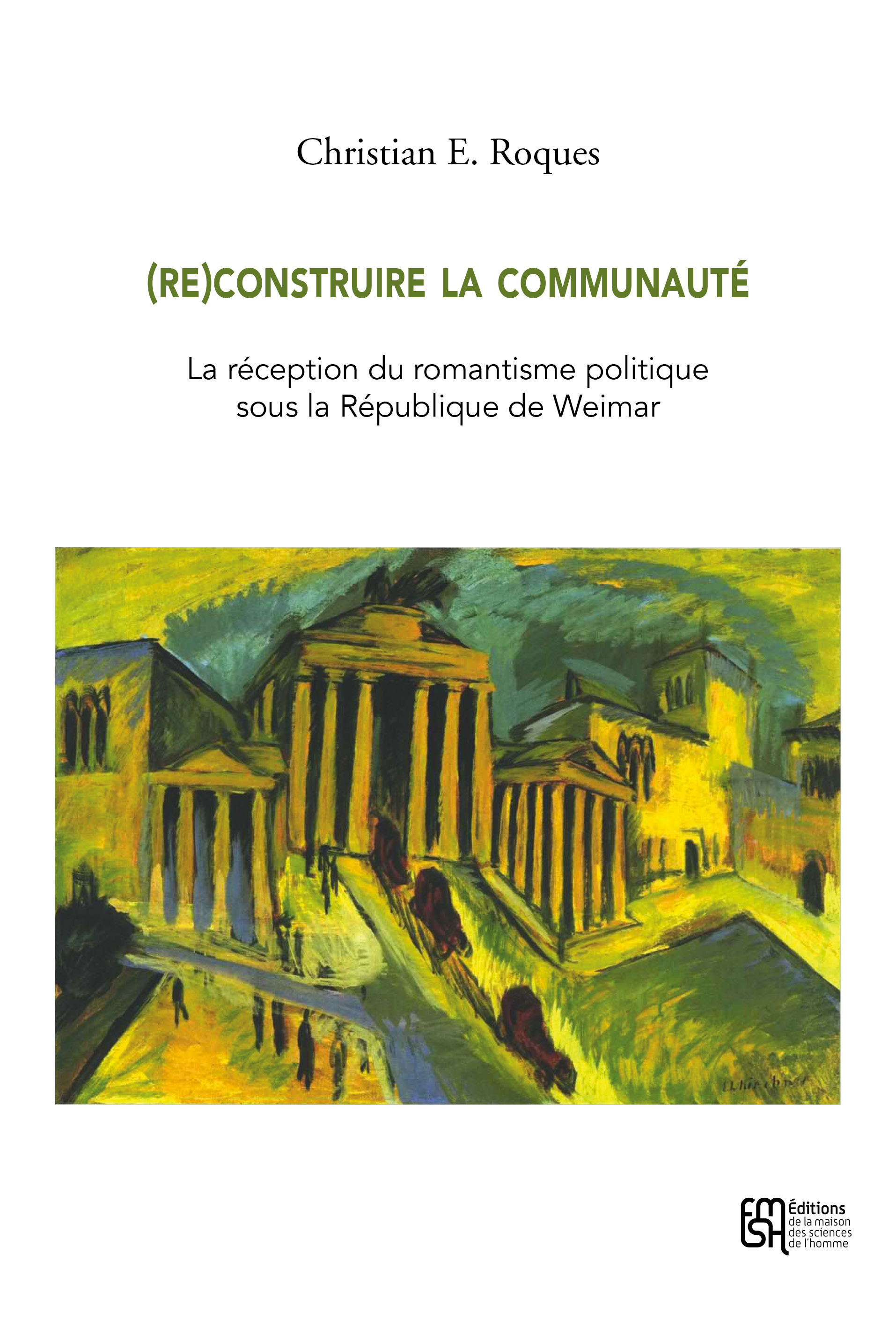
(Re)construire la communauté
La réception du romantisme politique sous la République de Weimar
Christian E. ROQUESCollection
Bibliothèque allemandeDate de publication
8 octobre 2015Résumé
Partant du constat que le paradigme du " romantisme politique " [politische Romantik] connaît un regain d'intérêt important en Allemagne sous la République de Weimar (1918-1933), au point de constituer un idéologème essentiel du discours politique de l'époque, en congruence avec les réseaux discursifs de la " communauté " [Gemeinschaft], de la " nation " [Nation] ou du peuple [Volk], qui sont les " mots magiques " (Kurt Sontheimer) de la vie intellectuelle weimarienne, le présent ouvrage procède à une analyse archéologique des discours sur le " romantisme politique " sous la République de Weimar.Par le recours à une conception de la " réception " qui met entre parenthèses la fonction " auteur " il s'agit d'analyser les stratégies discursives qui se structurent autour du ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
19.00 €
Ajout au panier /
