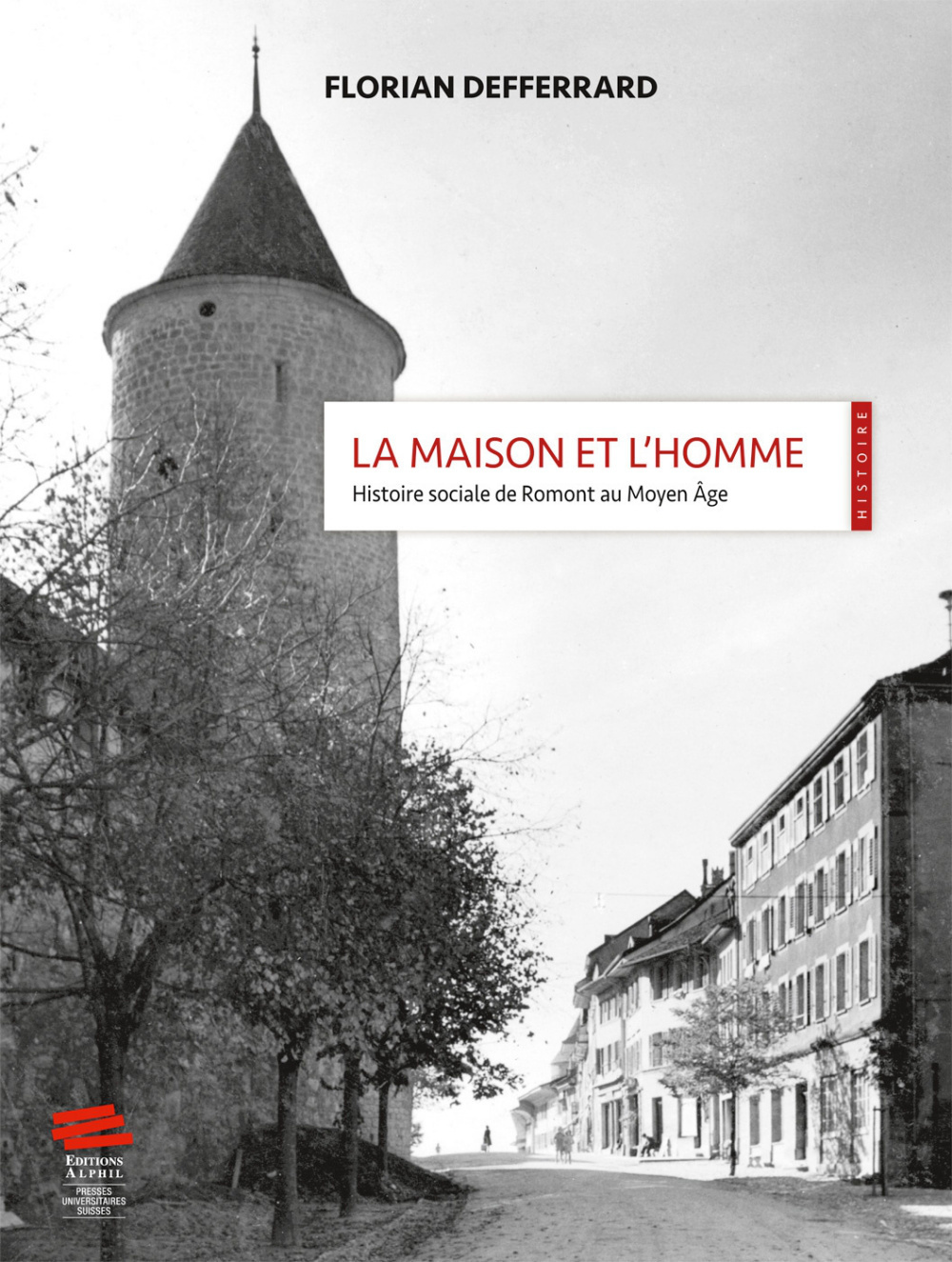
La Maison et l'homme
Histoire sociale de Romont au Moyen Âge
Florian DEFFERRARD
Résumé
Au moment où la Peste noire frappe Romont en 1349, la mort et la peur fauchent près de la moitié de la population de cette ville d'environ 1800 habitants. Dix ans plus tard, les effets dévastateurs de cette épidémie sont encore perceptibles mais on décèle déjà les prémices d'une reprise. Face aux crises, la famille, noyau de base de la société, réagit rapidement en trouvant de nouveaux modes d'organisation.Observer l'évolution démographique de la ville de Romont entre 1250 et 1450 par le biais des reconnaissances et des comptes de l'administration savoyarde, c'est prendre le pouls d'une communauté dont le coeur bat au rythme des crises et des épidémies. C'est surtout appréhender la précarité dans laquelle vit la population médiévale. Cette fragilité est compensée par un ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
29.00 €
Ajout au panier /
