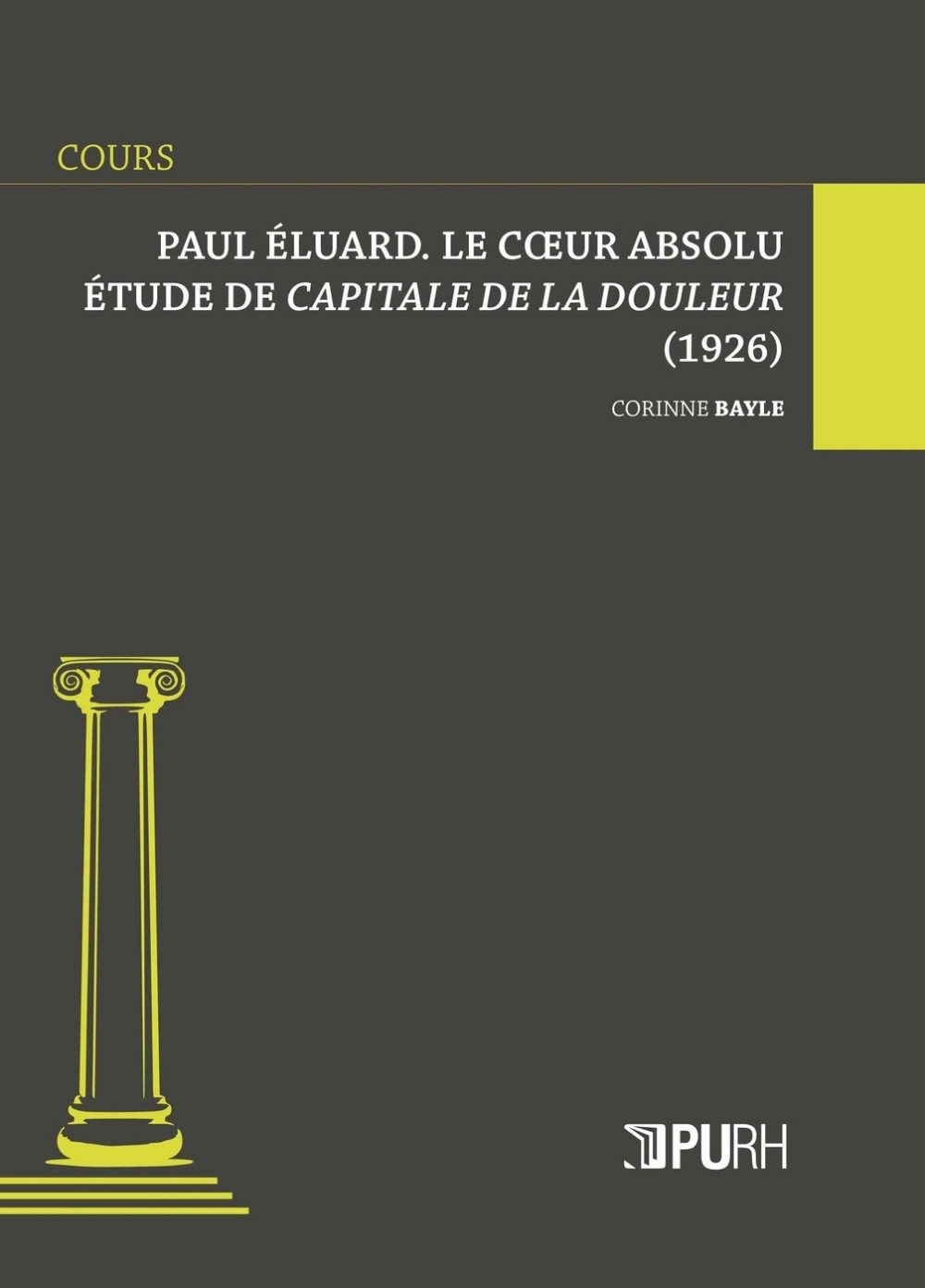
Paul Éluard. Le coeur absolu
Étude de Capitale de la douleur (1926)
Corinne BAYLE
Résumé
Souhaitant affranchir le nom d'Éluard des lieux communs du sentimentalisme, cette étude de Capitale de la douleur (1926) se veut attentive au cœur absolu du poème. Dans l'espace de la page s'opère une transmutation de l'expérience par la figuration d'un " je " universel qui redistribue les affects en chant impersonnel. De dada au surréalisme, le recueil s'inscrit en une époque de révolutions esthétiques, tout en conservant la mémoire vive de la poésie. Il invente ses propres modèles, regardant vers les tableaux et les collages, les rêves et les proverbes, à la lumière d'un lyrisme neuf. En une position éthique, le poète forme le vœu de partager " les débris de toutes [s]es merveilles " qui sont autant de fragments de réel. Le sourire triste ne fait pas écrire: c'est la ...
Lire la suite
FORMAT
Produit proposé à la vente en plusieurs composants
13.20 €
Livre broché
12.00 €
Ajout au panier /
