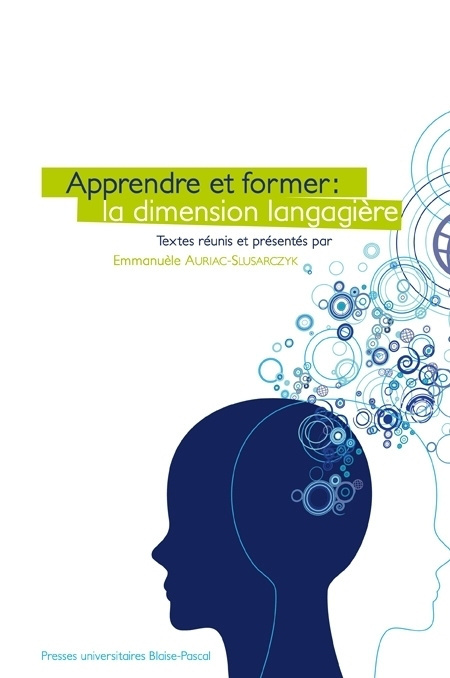
Apprendre et former : la dimension langagière
Emmanuèle AURIAC-SLUSARCZYKCollection
Sphère éducativeDate de publication
7 octobre 2013Résumé
Cet ouvrage est le fruit du travail d'enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation qui s'attachent à décrire des situations scolaires de la maternelle à l'université. Comment un enseignant gère-t-il ses prises de parole pour engager des élèves dans les activités scolaires ? À quoi et à qui sert la verbalisation ? Parle-t-on de la même manière en maternelle et à l'université ? La prise de parole – d'écoliers, de professeurs débutants ou plus aguerris, etc. – peut se saisir de diverses manières. Parler est toujours lié au contexte et creuse les inégalités sociales, scolaires, cognitives. Il est nécessaire de former les enseignants à la prise de parole car parler, c'est avant tout lever des malentendus.
FORMAT
Livre broché
25.00 €
Ajout au panier /
